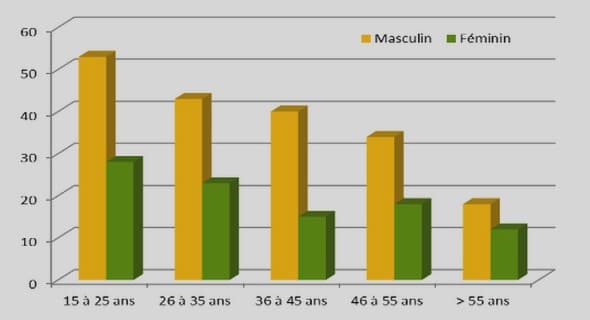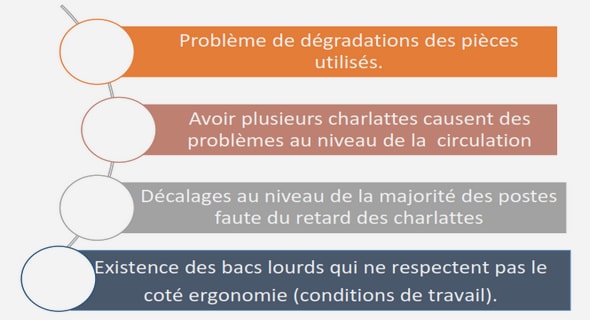Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La fonction de la théorie dans la philosophie de Descartes
Cette théorie foncièrement cartésienne présente les vérités éternelles comme des créatures. Elles sont dites éternelles, non pas parce qu’elles se sont imposées à Dieu, mais parce que Dieu les a voulues ainsi. Ce ne sont pas des vérités qui lui auraient été imposées de l’extérieur. Il n’y a aucune nature essentielle dont il ne soit l’auteur. Si par exemple, cette vérité « la somme des angles d’un triangle est égale à deux droits » est vraie, ce n’est pas parce qu’elle s’est imposée à lui et que cela ne pouvait en être autrement. Mais parce qu’il a voulu que cela soit vrai que c’est vrai. Donc, Dieu est créateur de ces vérités et Descartes présente cette thèse comme un prélude métaphysique à sa physique. Qu’en résulte-t-il quand les vérités mathématiques sont qualifiées de créatures ?
Il convient de noter la position de Ferdinand Alquié qui ne parvient pas « à croire que cette théorie s’explique par un but, une fin réfléchie »2. Pour notre part, nous pensons d’abord qu’elle a permis à Descartes de souligner avec force l’infinité de Dieu en reconnaissant qu’il est créateur de tout ce qui est. La préoccupation des vérités éternelles nous semble suggérer, comme l’indique le ton, la volonté de remettre Dieu dans ses prérogatives, qu’il ne soit pas confondu avec les Destinées, Jupiter ou Saturne. Il n’a pas non plus à être confondu avec ce qui est humain ou créé. A Beeckman, dans sa correspondance du 17 octobre 1630, Descartes lui fait savoir que limiter la puissance de Dieu est une indécence. Descartes trouve dans la libre création des vérités éternelles, une opportunité pour défendre l’existence de Dieu et pour exalter sa toute-puissance qui, étant cause, surpasse les bornes de l’entendement humain. Par conséquent, en posant Dieu comme créateur de tout ce qui est, Descartes entend déréaliser la nature, lui faire perdre le caractère sacré que lui prêtait le naturalisme spécifique à la Renaissance pour lui dénier ainsi toute profondeur ontologique. Certainement, Descartes y voyait du paganisme en filigrane. Car le naturalisme considérait que la nature possédait des forces occultes. En établissant cette théorie, la visée de Descartes consiste à vouloir reporter tout être, tout ce qui est humain et créé à la seule volonté de Dieu. Il a voulu ainsi instituer entre l’homme et Dieu une connexion dans laquelle la nature créée se voit ôter tout pouvoir opacifiant pour ne laisser subsister qu’une pure relation de volonté à volonté. De ce point de vue, parce qu’elle prône la séparation de Dieu de sa créature, elle rend en même temps la physique indépendante de la théologie. En effet, les vérités éternelles étant une création de Dieu, celle-ci n’a aucune profondeur ontologique et la physique qui s’en occupe n’a pas à s’occuper de l’être.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, nous pouvons comprendre le sens des propos de Descartes lorsqu’il répond à la question de Mersenne, celle de savoir par quel genre de causalité Dieu a créé les vérités éternelles. Notre lecture sur ce point ne rejoint pas celle que fait Jean-Marie Beyssade, pour qui « dans ce rapport d’efficace, l’accent n’est pas mis sur le caractère contingent des vérités créées », et pour qui « il n’est pas sûr qu’il s’insurge contre leur nécessité »1. Pour nous, déclarer que « c’est par le même genre de causalité qu’il a créé toutes choses, c’est-à-dire comme une cause efficiente et totale », c’est restituer aux vérités éternelles leur caractère propre : elles sont contingentes et n’ont pas une nécessité absolue. Les lois générales de la nature ne tiennent leurs certitudes que de l’éternité et de l’immutabilité de leur auteur.
C’est ainsi que Descartes conduit jusqu’à ses limites extrêmes cette thèse de la création des vérités, connue pour être celle qui inaugure sa métaphysique et permet de mieux la comprendre, lorsqu’il déclare : « sa volonté n’est pas seulement la cause des actuelles et futures, mais aussi des choses possibles et des natures simples, et rien ne peut ou ne doit être imaginé que nous disions ne pas dépendre de Dieu »2. Selon Descartes, la nécessité que nous reconnaissons aux vérités éternelles dépend de la part de Dieu, d’une libre création. Parmi ces vérités, aucune ne précède dans le temps la libre création de Dieu. Elles sont donc contingentes. Leur nécessité à notre égard est le fait du décret arbitraire de la toute-puissance de Dieu qui les a rendues telles. Comme tous les autres attributs de Dieu, son indifférence à leur sujet est infinie et absolue. Dans ses réponses aux sixièmes objections, Descartes écrit : « il répugne que la volonté de Dieu n’ait pas été de toute éternité à toutes les choses qui ont été faites ou qui se feront jamais, n’y ayant aucune idée qui représente le bien ou le vrai, ce qu’il faut croire, ce qu’il faut faire, ou ce qu’il faut omettre, qu’on puisse feindre avoir été l’objet de l’entendement divin, avant que sa nature ait été constituée telle par la détermination de sa volonté »1. C’est Dieu qui a imposé les lois en la nature sans que celles-ci s’imposent à lui. En créant les vérités éternelles, Dieu n’était soumis à aucune nécessité extérieure à lui-même. Il n’y a rien qui aurait pu déterminer sa volonté, ni le vrai, ni le bien, encore moins à vouloir ce qu’elle a voulu.
Comme tout dépend de lui, y compris les natures simples, et comme pour montrer leur contingence, Descartes note également que la liberté de Dieu pouvait faire que les évidences logiques, les théorèmes mathématiques ne soient pas vrais et qu’il ne soit pas contraint de suivre le principe de contradiction. Dans ce sens, les vérités éternelles seraient-elles soumises à l’arbitraire divin, et donc au changement ? Descartes reconnaît qu’il y a une difficulté à concevoir à la fois la liberté de Dieu et son indifférence en établissant les vérités éternelles. Ou encore comment a-t-il fait pour que les contradictoires ne puissent être ensemble. Cette difficulté aux yeux de Descartes ne peut être résolue qu’en considérant la puissance de Dieu qui est sans borne ; « puis, aussi, en considérant que notre esprit est fini, et créé de telle nature, qu’il peut concevoir comme possibles les choses que Dieu a voulu être véritablement possibles, mais non pas de telle, qu’il puisse aussi concevoir comme possibles celles que Dieu aurait pu rendre possibles, mais qu’il a toutefois voulu rendre impossibles »2.
En effet, la puissance divine est capitale pour comprendre la question de l’arbitraire supposé de la volonté divine. On a objecté à Descartes que si les vérités éternelles sont le résultat d’un acte posant de Dieu, elles changeraient, si la volonté de Dieu venait à changer. Descartes dans sa lettre du 15 avril 1530 répond en affirmant que la volonté de Dieu est immuable et par conséquent n’est pas sujet au changement. Il demeure identique à soi-même. Sa volonté est certainement libre, mais n’est pas pour autant arbitraire, car « sa puissance est incompréhensible ». C’est toujours lanotion de la puissance infinie de Dieu qui est évoquée pour nous permettre de comprendre l’immutabilité de la volonté divine. C’est ainsi que Descartes peut affirmer que « nous pouvons bien assurer que Dieu peut faire tout ce que nous pouvons comprendre, mais non pas qu’il ne peut faire ce que nous ne pouvons pas comprendre ; car ce serait témérité de penser que notre imagination a autant d’étendue que sa puissance »1. Pour Descartes, quoique créées, ces vérités sont éternelles parce que la volonté de Dieu qui les établies est immuable comme le sont ces vérités. En clair, si ces vérités ne peuvent pas changer, ce n’est pas parce qu’elles sont elles-mêmes immuables, mais c’est parce que la volonté de Dieu qui les établit est immuable qu’elles ne changent pas.
Faut-il remarquer, à la suite de ce qui vient d’être dit, que la manière d’envisager la contingence des vérités éternelles entraîne ou induit l’idée de l’indifférence de l’action de Dieu ? Ce qui conduit Descartes à dire : « et ainsi une entière indifférence en Dieu est une preuve très grande de sa toute-puissance »2. Par conséquent, la contingence s’impose, en vertu de la théorie de la création des vérités éternelles, comme l’indice qui révèle l’indifférence divine tant pour les choses existantes que pour les vérités éternelles.
La Métaphysique cartésienne, fondement de la philosophie naturelle.
Dans le point précédent, nous avons tenté de montrer comment la théorie cartésienne de la création des vérités éternelles fonde la conception cartésienne de la nature. Mais ce thème ne constitue pas le seul fondement de sa philosophie naturelle. Lorsqu’il écrit à Mersenne, il lui annonce que : « ce peu de métaphysique que je vous envoie, contient tous les principes de ma physique »1. Plus éclairante encore est sa lettre du 28 janvier 1641 au même correspondant dans laquelle il lui révèle sa motivation profonde lorsqu’il entreprend d’écrire et de publier ses Méditations. « Ces six méditations, écrit Descartes, contiennent tous les fondements de ma physique. Mais, il ne le faut pas dire s’il vous plaît ; car ceux qui favorisent Aristote feraient peut-être plus de difficulté de les approuver ; et j’espère que ceux qui les liront s’accoutumeront insensiblement à mes principes, et en reconnaîtront la vérité avant que de s’apercevoir qu’ils détruisent ceux d’Aristote »2.
De ce qui vient d’être dit, l’on peut comprendre que Descartes assigne à sa métaphysique un double objectif : fonder sa physique et disqualifier celle d’Aristote.
Il nous appartient maintenant d’indiquer dans quel sens et pour quelle raison, elle poursuit ce double objectif.
L’existence du moi comme res cogitans.
Nous savons que Descartes s’était engagé à travers le doute méthodique et universel à chercher à atteindre une première vérité indubitable laquelle lui permettrait d’édifier toute la connaissance humaine. C’est-à-dire une vérité suffisamment féconde qui sera le fondement de toute la connaissance et de tout le savoir. Dans les Méditations, cette première vérité est évidemment la fameuse proposition « je suis, j’existe ». Ensuite, Descartes entreprendra de chercher à savoir la nature, ou l’essence de ce moi qui existe. C’est tout le travail d’éclaircissement qu’entreprendra la deuxième Méditation pour arriver à cette conclusion : « je ne suis donc, précisément parlant, qu’une chose qui pense »1 (res cogitans). Une fois que l’existence du moi ainsi que sa nature comme pensée sont posées, Descartes poursuit la seconde Méditation en la centrant sur la séparation de l’esprit et de l’imagination.
Pour Descartes, la connaissance du moi ne dépend pas de l’imagination. A ce propos, il écrit : « il est très certain que cette notion et connaissance de moi-même, ainsi précisément prise, ne dépend point des choses dont l’existence ne m’est encore connue ; ni par conséquent, et à plus forte raison, d’aucune de celles qui sont feintes et inventées par l’imagination »2. Descartes affirme l’indépendance, de manière plus nette, de l’esprit dans la connaissance du moi vis-à-vis de l’imagination. Quelques lignes plus loin, il réaffirme que : « rien de tout ce que je puis comprendre par le moyen de l’imagination, n’appartient à cette connaissance que j’ai de moi-même, et qu’il est besoin de rappeler et détourner son esprit de cette façon de concevoir, afin qu’il puisse lui-même reconnaître bien distinctement sa nature »3.
En effet, comment déterminer quelque chose de fixe qui demeure au sein du changement ? Qu’est-ce qui me permet de penser une chose comme un objet doté d’une unité qui regroupe des qualités diverses, permanent à travers le temps ? C’est alors que dans la suite du texte Descartes évoque l’expérience du morceau de cire dans le même but de se garantir ou de rechercher la confirmation de la priorité de la connaissance de mon esprit sur celles de l’objet de l’intellect et l’objet de l’imagination. Martial Gueroult note à propos : « la conscience m’a fait connaitre clairement et distinctement dès la deuxième Méditation que l’imagination est différente du pur intellect et n’appartient pas à l’essence de mon esprit, lequel peut exister sans elle »1.
Pourtant, à en croire Aristote, « quant à l’âme, les images remplissent pour elle le rôle des sensations. Dès qu’elle affirme ou qu’elle nie la chose est bien ou mal elle la recherche ou la fuit. Voilà pourquoi cette âme ne pense jamais sans image »2. En effet, Aristote parle de ce qu’il appelle « La pensée discursive de l’âme » en évoquant régulièrement ou même assez souvent les rapports de celle-ci avec les sensations, « et définit, comme une conséquence de cette étroite relation ou indétermination le rôle effectif des images… après avoir précisé que ces images-ci sont à l’âme ce que les sensations sont aux sens »3.
Saint Thomas pour sa part, à la suite d’Aristote concède la primauté ontologique de l’imaginaire sur le conceptuel. Toute connaissance se fait par la médiation d’une certaine similitude de l’objet ; notre esprit ne pense rien sans fantasme. Pour lui, la connaissance de soi n’est possible que lorsque l’âme appréhende d’abord d’autres choses. Or, saint Thomas considère que l’intellect a comme objet premier « la nature de la chose matérielle »4. Il doit se convertir à l’image pour appréhender son objet. Dans ce sens, la connaissance de soi est considérée comme un acte second qui vient s’ajouter à l’acte de connaitre l’objet sensible par l’intermédiaire de l’image.
A l’inverse de la tradition aristotélicienne, Descartes affirme ici l’indépendance de l’esprit qui se connait sans se convertir à l’image ou l’imagination. Il soutient l’unicité de la pensée et de la réflexion sur elle. La pensée pensante et la pensée pensée ne font qu’une seule et même chose, un même acte qui est être conscient. Pour celle par laquelle nous apercevons que nous l’avons déjà aperçue. Car, pour lui, « être conscient, c’est assurément penser et réfléchir sur sa pensée, mais que cela ne puisse se faire tant que subsiste la pensée précédente, c’est faux, parce que l’âme peut penser plusieurs choses en même temps, persévérer dans sa pensée, et toutes les fois qu’il lui plaît réfléchir sur ses pensées, ainsi, être consciente de sa pensée »5. Ce qui est souligné, c’est le caractère absolument unique et simple de l’acte par lequel la pensée se saisit l’imagination, selon laquelle « à proprement parler nous ne concevons les choses que par la faculté d’entendre qui est en nous et non point par imagination ni par les sens, et que nous ne les connaissons pas de ce que nous les voyons, ou que nous les touchons, mais seulement de ce que nous les concevons par la pensée, je connais évidemment qu’il n’y a rien qui me soit plus facile à connaitre que mon esprit »1. Ce qui veut autrement dire que la connaissance que nous avons de notre âme ou de notre pensée est plus certaine que celle de notre corps et la précède. Contrairement à la tradition aristotélicienne, le premier objet de l’intellect ici n’est plus l’objet sensible ou l’image, mais notre esprit lui-même. La dissociation de l’esprit et du corps induit le primat épistémologique de l’esprit sur l’objet sensible et constitue par ce fait la destruction de la tradition aristotélicienne. « Les pensées vraies […] écrit Hegel, peuvent seulement se gagner par le travail du concept. Le concept
peut seul produire l’universalité du savoir »2.
L’expérience du morceau de cire, outre ce qu’elle nous renseigne sur la connaissance du moi, nous livre également le rôle de l’imagination pour ce qui concerne la connaissance de l’essence des choses matérielles. Ainsi, Descartes en poursuivant sa Méditation sur l’analyse du morceau de cire, fait observer que l’imagination est incapable de me fournir la connaissance de la cire. Car dans son essence, la cire revêt une infinité des formes qui laissent comme hors-jeu l’imagination. Celle-ci est incapable de se représenter une telle infinité de forme et de mouvement. « Et par conséquent, écrit Descartes, cette conception que j’ai de la cire ne s’accomplit pas par la faculté d’imaginer »3, mais seulement par une inspection de l’esprit. Dans cette expérience du morceau de cire, Descartes n’accorde pas à l’imagination un rôle déterminant dans la connaissance de l’essence des choses matérielles. Pour lui, c’est l’entendement qui perçoit le corps et non l’imagination parce que seul l’entendement est capable de concevoir la cire à travers ses multiples changements et déterminer que c’est la même cire. Sur l’analyse du morceau de cire, nous aurons à faire des analyses assez approfondies quand nous aurons établi le rapport de l’homme à la nature à travers les différentes occurrences du mot nature chez Descartes. Mais à ce stade nous voulons seulement montrer que l’une des fonctions de l’analyse du morceau de cire est de hiérarchiser les éléments du cogito, et de découvrir l’entendement à la racine de l’imagination et de la sensation. La puissance de former l’idée de l’essence des choses corporelles, selon Descartes, revient à l’entendement pur et non à l’imagination qui s’y voit privée comme l’indique justement l’analyse du morceau de cire.
Pour former l’idée des choses matérielles, l’empirisme aristotélicien ordonnait l’entendement humain de se tourner vers l’imagination. L’analyse du morceau de cire se veut une déconstruction de cet empirisme aristotélicien et prépare, pour ainsi dire, l’innéisme des idées dans l’intention d’établir l’essence des choses matérielles partant des idées mathématiques dans l’entendement. L’on comprendra aisément qu’en dissociant les idées dans l’entendement et les images dépeintes dans l’imagination, Descartes déconstruit l’empirisme aristotélicien et lance les bases de sa théorie de la connaissance. Pour concevoir des choses corporelles ou spirituelles, on n’a plus besoin de l’image, toute intellection pure se fait sans elle. C’est ce que Descartes affirme dans les Réponses aux Cinquièmes Objections : « La conception ou l’intellection pure des choses, soit corporelles, soit spirituelles, se fait sans aucune image ou espèce corporelle »1.
La preuve de l’existence des choses matérielles et leur essence comme étendue.
Nous avions souligné dans les pages précédentes que l’une des questions les plus originales abordées par la philosophie de Descartes consiste dans son idée directrice de vouloir étendre à tous les domaines de la connaissance la méthode mathématique de l’évidence. L’auteur s’est aussi rendu compte que le risque de fausse clarté est toujours possible et capable de rendre l’évidence trompeuse. C’est ainsi que Descartes fait dépendre la règle de l’évidence de Dieu. Substance souverainement parfaite, Dieu me garantit en effet que les idées que je conçois comme claires et distinctes sont vraies. C’est encore sous cette dépendance ou subordination de l’évidence à Dieu que Descartes cherchera à faire reposer la détermination de l’essence des corps physiques par des idées mathématiques en nous. Ainsi, « faut-il avouer que toutes les choses que j’y conçois clairement et distinctement, c’est-à-dire toutes les choses, généralement parlant, qui sont comprises dans l’objet de la géométrie spéculative, s’y retrouvent véritablement »1. Donc, nous sommes assurés que tout ce que nous concevons clairement et distinctement est vrai parce que ce Dieu, qui a la puissance de produire toutes ces choses, a également imprimé ces choses en nous. En d’autres termes, avec la subordination à Dieu de la règle de l’évidence, j’ai le moyen, connaissant l’essence des corps physiques, à savoir l’étendue géométrique, de savoir qu’il existe des corps, et donc la physique a un objet. C’est tout ce qu’il faut pour fonder la physique comme science du réel. Par-là, l’étendue est posée définitivement comme l’essence des choses matérielles.
A-t-on le droit de conclure, à l’examen des Méditations, que la philosophie naturelle de Descartes se termine par la détermination mathématique de l’essence des choses corporelles ? Y a-t-il adéquation entre élaborer les idées des essences des choses hors de nous pour les leur appliquer et constater qu’elles sont en réalité telles que nous nous les représentons ? D’où la stricte nécessité d’examiner si notre représentation de l’essence des choses matérielles correspond à leur réalité hors de nous. Or il s’avère que les idées en nous sont contingentes. Ainsi, on ne peut pas se permettre de conclure à brûle-pourpoint de l’essence à l’existence. L’auteur des Méditations métaphysiques va se forcer de trouver un accès pouvant conduire aux réalités sensibles hors de nous. Eu égard à cela, il commence par s’appuyer sur l’imagination, qu’il estime ne pas faire partie obligatoirement de sa nature susceptible de se constituer en instance de perception. Descartes fait remarquer dans son analyse que la faculté d’imaginer (et de sentir) « dans son concept formel, renferme quelque sorte d’intellection », mais ne lui reconnaît aucune fonction essentielle dans la connaissance de l’essence des choses matérielles. « Elle est pour une pareille entreprise définitivement hors-jeu »1, comme l’affirme Martial Gueroult.
N’étant pas parvenu par l’imagination d’ouvrir un accès à la sphère extérieure des choses matérielles, la trouvant incapable de démontrer l’existence des corps, mais seulement leur probabilité, Descartes estime à propos d’examiner « ce que c’est que sentir ». Il s’agit de voir « si des idées que je reçois en mon esprit par cette façon de penser, que j’appelle sentir, je puis tirer quelque preuve certaine de l’existence des choses corporelles »2. Etant assuré de disposer de la connaissance de soi-même, et convaincu d’avoir découvert plus clairement celui qui est l’auteur et l’origine de son être, Descartes juge ne pas penser à la vérité qu’il doit témérairement admettre toutes les choses que les sens lui semblent enseigner. Mais il ne pense pas non plus qu’il doive toutes généralement les révoquer en doute. Les sens étant aussi produits de Dieu, Descartes estime qu’ils peuvent disposer de quelques vérités. L’auteur des Méditations métaphysiques s’appuie encore sur la puissance de Dieu qui peut produire dans la réalité tout ce que nous concevons clairement et distinctement. C’est clairement évident qu’à ce stade de la sixième méditation, la différence entre les philosophes idéalistes et Descartes devient perceptible. Les idéalistes conçoivent, bien qu’à des accents différents, le domaine des sens comme réduit à une production idéale, astreint pour ainsi dire aux constructions de l’intellection. L’altérité de la réalité est réduite dans sa totalité par les philosophes idéalistes à de l’intelligible. Pour monde extérieur bénéficie d’un contenu qui échappe à l’intellection, contenu auquel elle n’a pas accès, mais que seul Dieu peut nous garantir. Ce qui explique ce constat auquel aboutit Descartes à l’issue de l’examen des sens. « Je reconnais aussi en moi quelques autres facultés, comme celles de changer de lieu, de se mettre en plusieurs postures, et autres semblables »1.
Remarquons d’abord que la suite du texte stipule clairement que les facultés de changer de lieu ou de se mettre en plusieurs postures et d’autres semblables doivent être attachées à la substance corporelle ou étendue. Car s’y trouve contenue, « dans leur concept clair et distinct », une sorte d’extension, mais point du tout d’intelligence. Ensuite, pour prouver la réalité d’une chose matérielle hors de moi, Descartes fait allusion à la présence en moi d’un principe de causalité attesté par une certaine contrainte que j’éprouve en moi. Parce que, dit Descartes, « il se rencontre en moi une certaine faculté passive de sentir, c’est-à-dire de recevoir et de connaitre les idées des choses sensibles. Mais, elle me serait inutile et je ne pourrais aucunement m’en servir, s’il n’y avait en moi ou en autrui, une autre faculté active, capable de former et produire ces idées. Or cette faculté active ne peut être en moi en tant que je ne suis qu’une chose qui pense, vu qu’elle ne présuppose point ma pensée, et aussi que ces idées-là me sont souvent représentées sans que j’y contribue en aucune sorte, et même souvent contre mon gré »2.
Le bon sens à l’épreuve du doute
Descartes ouvre son Discours de la méthode par une déclaration qui est en réalité une opinion commune : le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais Descartes constate également que « chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter à toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont »1. Ce que Descartes entend par le bon sens n’est rien d’autre que « la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux ». A Burman, Descartes livre sa propre relecture du début de son Discours et avoue qu’« il y en a beaucoup qui reconnaissent être inférieurs aux autres pour l’intelligence, pour la mémoire, etc. Mais cependant chacun pense qu’il excelle par le jugement, par l’aptitude à donner un avis au point d’être l’égal de tous les autres en cette matière. A chacun sourit son avis. Autant de têtes, autant de façons de voir »2. Que les hommes soient si satisfaits de leur jugement, parce que la puissance de bien juger est égale chez tous, cela est, bien entendu, connu de tous. « Autant de têtes, autant de façons de voir », tente-t-il de rappeler à Burman. Mais là où l’on retrouve du Descartes, c’est lorsqu’il indique par quelle voie nous devons conduire nos pensées. Si la raison est reconnue comme commune à tous les hommes de façon équitable, cela est alors une preuve « que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies ». Et notre auteur de conclure : « car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien »3. Donc, le bon sens ne suffit pas, mais le principal est ce qu’il faut savoir pour acquérir l’habitude de bien penser. En d’autres termes, le bon sens est toujours déjà et nécessairement indissociable de la méthode qui fait qu’il soit bon. Cette nécessité de bien conduire nos pensées dès lors que nous sommes tous dotés du bon sens, Descartes l’exprime aussi dans la Lettre-Préface en ces termes : « J’ai pris garde, en examinant le naturel de plusieurs esprits, qu’il y en a presque point de si grossiers ni de si tardifs, qu’ils ne fussent capables d’entrer dans les bons sentiments, et même d’acquérir toutes les plus hautes sciences, s’ils étaient conduits comme il faut »4.
Cependant, cette invitation à l’évidence ne va pas sans solliciter quelques incertitudes, et donc quelque doute. C’est ainsi que Père Mersenne fait parvenir à Descartes cette objection de certains théologiens et philosophes : « Et d’où avez-vous appris que, touchant les choses que vous pensez connaître clairement et distinctement, il est certain que vous n’êtes jamais trompé, et que vous ne le pouvez être ? Car combien de fois avons-nous vu que des personnes se sont trompées en des choses qu’elles pensaient voir plus clairement que le soleil ? »1. L’objection est de taille et observe qu’il ne suffit pas de penser connaître ou voir clairement et distinctement que l’on ne peut pas se tromper. Même ce qui peut être considéré comme évident peut se révéler sans cohérence. Mais sur ce point, Descartes est d’une lucidité exemplaire qui a peut-être échappé à ses objecteurs. Parce que lui-même déclare dans le Discours de la méthode que « souvent les choses qui m’ont semblé vraies, lorsque j’ai commencé les concevoir, m’ont paru fausses, lorsque je les ai voulu mettre sur le papier »2. Même lorsqu’il découvre l’évidence de « je pense, donc je suis » comme modèle de toute évidence, au moment d’établir la règle générale, Descartes n’occulte pas la difficulté de son établissement et s’exprime en ces termes : « Et ayant remarqué qu’il n’y a rien du tout en ceci : « je pense, donc je suis, qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois très clairement que, pour penser, il faut être : je jugeai que je pouvais prendre pour règle, que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies ; mais qu’il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement »3. Et comme l’indique la première Méditation, cette difficulté est ce qui va engendrer le premier moment de l’entreprise philosophique de Descartes. « Il y a déjà quelque temps écrit Descartes, que je me suis aperçu, dès mes premières années, j’avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j’ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain »4. L’on comprend dès lors que l’expérience que fait Descartes est celle d’un homme qui se croit riche, mais avec des poches remplies de fausses monnaies. Autrement dit, avant l’évidence, il y a la pseudo-évidence comme le moment marquant l’origine d’une philosophie de l’évidence. C’est ainsi que Descartes, lorsqu’il écrit le Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, sait d’expérience ce que signifie une raison mal conduite, prenant ainsi le familier pour le rationnel.
Par conséquent, Descartes qui a conscience du caractère ambigu de toute évidence, s’évertuera à définir les moyens de reconnaître une évidence de ses contrefaçons. En relisant attentivement le premier précepte de la méthode, on peut se rendre compte que, non seulement que Descartes indique que la fin, c’est l’évidence, mais aussi qu’il signale les dangers à éviter pour l’atteindre. Ainsi y lit-on : « … ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention »1. Pour distinguer le vrai d’avec le faux. Cet objectif peut ne pas être atteint lorsque le jugement affirme trop vite ou lorsqu’il est une reprise d’un jugement tout fait. Certes, il convient de retenir son jugement en évitant la précipitation et la prévention. Mais pour atteindre l’évidence de façon certaine, Descartes conseille, toujours dans ce premier précepte de la méthode, de « ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute »2. Ce qui résiste au doute est donc le signe de la vérité.
|
Table des matières
Introduction générale
CHAP. I. LES FONDEMENTS DE LA CONCEPTION CARTESIENNE DE LA NATURE
I.1. Théorie de la création des vérités éternelles
I.1.1. Le sens et la portée : l’approfondissement du sens
I.1.2. La fonction de la théorie dans la philosophie de Descartes
I.1.3. La théorie comme l’abrégé de l’ontologie cartésienne
I.2. La métaphysique cartésienne, fondement de la philosophie naturelle
I.2.1. L’existence du moi comme res cogitans
I.2.2. Dieu comme cause efficiente
I.2.3. La preuve de l’existence des choses matérielles et leur essence comme étendue
CHAP. II : L’ESPRIT HUMAIN ET DIEU COMME TRANSCENDANT LA MONDANITE
II. 1. L’illusion du monde sensible
II. 1.1. La distanciation représentationnelle
II. 1.2. Le bon sens à l’épreuve du doute
II. 1.3. Du doute du monde au doute des opinions
II. 1.4. Le doute, preuve de l’humanité
II. 2. De l’effondrement complet à la certitude
II. 2.1. La découverte du cogito
II. 2.2. La réalité et le rôle des idées innées
II. 2.3. De l’idée de l’infini en nous : Dieu dans les limites de la simple raison
II. 2.4. La véracité divine
CHAP. III : LE RAPPORT DE L’HOMME A LA NATURE
III. 1. Nature comme ensemble des choses extérieures
III. 1.1. Nature comme matière
III. 1.2. La finalité de la connaissance de la nature
III. 1.3. Le vrai maître, c’est Dieu
III. 1.4. Nature comme artifice divin : un affranchissement de l’esprit
III. 2. Nature comme rapport de l’homme avec lui-même
III. 2.1. Nature enseignante
III.2.2. Nature instituante
III. 2.3. La lumière naturelle
III. 3. Nature comme composé du corps et de l’âme
III. 3.1. La distinction réelle comme hypothèse cognitive
III. 3.2. L’union comme effectivité du vrai homme : ma nature
III 3.3. La conception cartésienne de la personne : le cogito affectif
III. 3.4. La vérité du dualisme : la dualité créatrice
CHAP. IV : DESCARTES ET LA PHILOSOPHIE DE L’ECORESPONSABILITE VIABLE
IV. 1. L’écologie profonde. Critique de l’antihumanisme de Arne Naess
IV. 2. L’heuristique de la peur de Jonas et la dérive totalitaire
IV. 3. Descartes, une philosophie de la responsabilité pour aujourd’hui ……
CHAP. V : LA PORTEE PHILOSOPHIQUE DU RAPPORT HOMMENATURE
V.1. Nouvelle conception du rapport à la matière
V.2. Nouvelle orientation en métaphysique
V.3. Un nouveau critère de vérité : vérité comme affaire de pensée
CHAP. VI : STATUT DE L’HOMME : CONSEQUENCES EPISTEMOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES
VI. 1. L’homme comme être doué du bon sens
VI. 2. L’homme capable d’oser le Je
VI. 3. L’homme comme être appliqué et impliqué
VI. 4. L’homme, levier de l’univers
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet