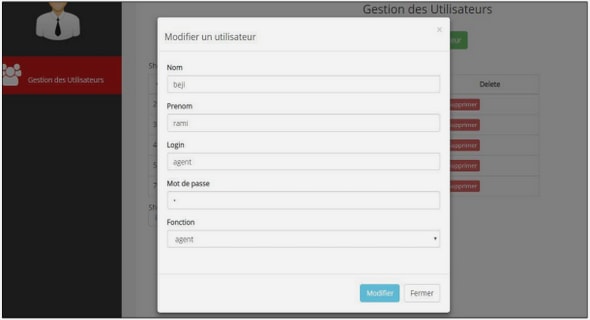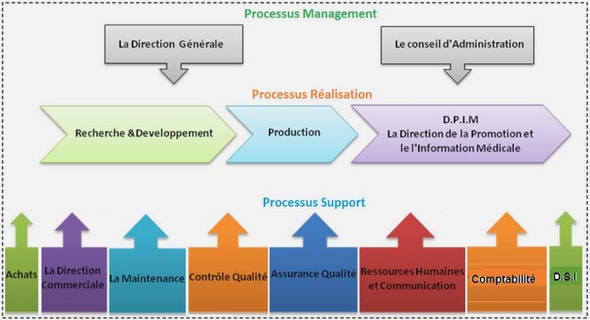Le contexte politico-religieux
L’étude de l’évolution de l’histoire de la France a toujours fait état d’une alliance entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Ces deux institutions représentées respectivement par l’État (ou la cour suivant le type de régime en place) et le clergé cohabitent ensemble dans une relation d’interdépendance. Afin de contrôler la population, le pouvoir politique a toujours cru indispensable de mettre et de maintenir sous sa coupole les différentes Églises et particulièrement l’Église catholique, tandis que cette dernière, s’appuie financièrement sur le régime politique en place pour étendre son influence et accroître ses biens. La période allant de 1852 à 1859, celle au cours de laquelle ont été publiées Les Fleurs du Mal et qui est la première section d’après la répartition de Jean Maurain dans son livre La politique ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869, fut un moment où les rapports entre le Second Empire et l’Église catholique furent assez satisfaisants. Ainsi, « l’État et l’Église s’unirent contre le monde des gens de Lettres, avec la pensée de leur interdire certains domaines de la pensée ». En fait, durant cette période et même un peu plutôt, vers 1848, ces pouvoirs n’ont cessé de poursuivre la littérature prétextant qu’elle était à l’origine de tous les maux : les journées de juin, le socialisme, la corruption des esprits etc. Á cette période, la France vivait sous un régime issu du coup d’État du 02 décembre 1852, mais les conjonctures ont changé les conditions de l’exercice du pouvoir. Le type de régime passe de la République à l’Empire. Louis Napoléon Bonaparte se proclame Napoléon III et impose au pays un règne sans partage : c’est l’empire autoritaire. Cette situation dura de 1852 à 1860. De connivence avec le Clergé, comblé de privilèges (constructions d’églises, augmentation du traitement des évêques, tolérance et entretien des congrégations), le pouvoir impérial disposait du droit divin. Ce constat et l’absolutisme du pouvoir de Napoléon III sous le Second Empire, Max Tacel le souligne dans ces propos : Le président, élu pour dix ans, détenait la totalité de l’exécutif, le droit de déclarer la guerre et de signer la paix ; il recevait le serment de fidélité des membres des chambres, des officiers, des magistrats, des fonctionnaires ; il empiétait sur le législatif par l’exercice exclusif de l’initiative des lois, le droit de convoquer, ajourner, proroger et dissoudre le Corps Législatif, d’en nommer le bureau et le président ;il désignait les sénateurs ; les ministres choisis par lui n’étaient responsables que devant lui, et il présidait leur conseil; le message annuel qu’il adressait au Corps Législatif ne comportait pas de réponse.[les chambres chargées de l’aider dans l’exercice des fonctions] étaient au nombre de trois : le conseil d’état formé de juristes nommés et révocables par le président, chargés de rédiger les projets de loi sous ses directives ; le Sénat(…), quelques-uns membres de droit(cardinaux, maréchaux, amiraux), les autres nommés à vie par président, qui devait sanctionner les lois ou invalider celles qui enfreindraient la morale, la religion et la constitution et pouvait modifier la constitution par Sénatus-consulte; le Corps Législatif(…) chargé de voter les lois et le budget présentés par le président.19 C’est donc mesurer l’étendue du pouvoir de l’empereur. Il a une main mise sur tous les secteurs. Même si la censure visait les journaux (qu’on contraignait à payer une amende pouvant aller jusqu’à 50000 de rente à Paris et Lyon), par rebond, l’État ruinait les écrivains qui vivent du journalisme par la critique littéraire, par la critique d’art, par le roman publié par feuilleton, par le compte rendu scientifique. C’était là un moyen de contrôler et d’anéantir les hommes de lettres. Cette période a été éprouvante pour certains écrivains et loin de favoriser et d’encourager les créations littéraires, le pouvoir les a même combattus. C’est ainsi qu’on assiste à la censure, concrétisée par la comparution devant les tribunaux, de deux des œuvres majeures de la littérature du XIXe siècle à savoir Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et Madame Bovary de Gustave Flaubert lors de leur publication en 1857 pour, respectivement, « outrage à la morale publique » et « outrage à la morale publique et religieuse ». Durant cette période, la censure est rigoureusement appliquée à la littérature et l’empereur et son plus proche entourage ont le pouvoir de censurer une œuvre ou pas. C’est témoigner donc du pouvoir absolu que détenait l’empereur et de l’éprouvante situation dans laquelle se trouvaient les écrivains. Á côté de cette dictature politique, il y a la société de l’époque, qui n’a pas aussi été conciliante avec Baudelaire.
La ville : lieu de manifestation du laid
La ville fait partie des nouveaux thèmes que Baudelaire a introduits dans la poésie française. Son idée de consacrer une étude à la grande ville s’est concrétisée en 1861 lors de l’introduction de la section «Tableaux Parisiens » dans la deuxième édition des Fleurs du Mal. Mais sa fascination pour la ville s’est fait sentir dans le Salon de 1859 lorsqu’il parle de Méryon en ces termes : J’ai rarement vu, représentée avec plus de poésie, la solennité naturelle d’une ville immense. Les majestés de la pierre accumulée, les clochers montrant du doigt le ciel, les obélisques de l’industrie vomissant contre le firmament leurs coalitions de fumée, les prodigieux échafaudages des monuments en réparation, appliquant sur le corps solide de l’architecture leur architecture à jour d’une beauté si paradoxale, le ciel tumultueux chargé de colère et de rancune, la profondeur des perspectives, augmentée par la pensée de tous les drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et le glorieux décor de la civilisation n’était oublié. Cela s’explique par le fait que de nombreux poètes négligeaient le thème de la ville au profit d’autres, et c’était aussi sa façon de répliquer aux poètes qui laissaient entendre « Copiez la nature ; ne copiez que la nature. Il n’y a pas de plus grande jouissance ni de plus beau triomphe qu’une copie excellente de la nature » et qu’aux yeux de Baudelaire la ville renfermait d’énormes sujets poétiques. Ainsi, on passe d’un décor de nature à un décor de « pierre et chair » et, cette idée, il le traduit dans « Rêve parisien »
Le sommeil est plein de miracles !
Par un caprice singulier
J’avais banni de ces spectacles
Le végétal irrégulier.
Et, peintre fier de mon génie,
Je savourais dans mon tableau
L’enivrante mélancolie
Du métal, du marbre et de l’eau.
C’est dire donc que Baudelaire fonde son monde idéal sur l’architecture, sur l’artificiel. L’introduction de la ville donne un nouveau tournant à la poésie. Précisons d’emblée que quand le poète parle de la ville, il s’agit de Paris ; ville dans laquelle il a passé toute sa vie (mis à part les voyages qui l’ont conduit hors de Paris) et qui représente tout pour lui. La poésie parisienne occupe dans Les Fleurs du Mal une place primordiale et cela pourrait s’expliquer en partie, par l’évènement de la révolution industrielle qui a fait de l’existence citadine au XIXème siècle en générale et celle à Paris en particulier, un phénomène sociologique qui a fasciné de nombreux écrivains comme Hugo, Balzac… Comme le dit Albert Thibaudet Paris est non la seule capitale, ni la plus grande, ni la plus riche […] ; mais il est la seule où l’homme vive profondément la vie propre d’une grande capitale, la seule où cette vie pousse tous les fruits spirituels, la seule où les puissances de la durée, du sol, du climat sont réunies […] pour donner à ce vin la plénitude de la qualité. […] Il était naturel que la vie d’une capitale produisît au dix-neuvième siècle une poésie qui épousât les mêmes fibres […]. Ainsi, la modernité se perçoit grâce à cette place importante qui est accordée au paysage urbain et qui est en parfaite connivence avec la nature de la poésie baudelairienne. La deuxième édition des Fleurs du Mal publiée en 1861 avec les « Tableaux Parisiens » en est une parfaite illustration. Pour Baudelaire, « La cité est un milieu proprement humain, créée par l’homme pour lui-même et qui manifeste toute l’ambiguïté de sa condition. Création, la ville dit la grandeur des pouvoirs de l’homme, mais lieu de la destruction et de la ruine, elle révèle la précarité de son destin. Elle est le paradoxe purement humain qui unit une « étonnante harmonie » au « tumulte de la liberté ».Elle concentre un grouillement d’existences contradictoires, de luxueuses et sordides, pures et infâmes, laborieuses et oisives, dans lequel l’individu peut reconnaitre la grouillante agitation de ses propres tendances ». De ce fait, la nature, décor privilégié des romantiques, cède sa place au paysage urbain que Baudelaire considère en substance comme un domaine riche en sujets poétiques et merveilleux mais qui ne fait pas l’objet d’attention. Cette section, « Tableaux Parisiens » (elle occupe la deuxième position dans l’édition de 1861), constitue un pas vers l’autre, à la rencontre de la « multitude », de la part du poète afin de se défaire de sa « solitude » après l’enfermement sur soi exprimé dans la section précédente : « Spleen et Idéal ». Ce mouvement permet, par la même occasion au poète, de montrer le décor de la ville : l’architecture et les êtres qui peuplent cet espace. Désormais, le visage de la ville change et elle devient par là même, le théâtre de toutes les métamorphoses comme cela se confirme avec ces vers : Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville Change plus vite, hélas !que le cœur d’un mortel) Cette transformation est le fruit des travaux d’Haussmann qui ont pour objectif de changer le visage de la capitale et elle s’inscrit dans le processus de modernisation. Cependant malgré tous ces efforts consentis sur le plan architectural et l’image de cette fourmillante cité, cité pleines de rêves, la population représentée vit dans la misère, la souffrance. La ville est peinte dans ses coins les plus misérables et sordides et Baudelaire donne vie et corps à ces êtres marginalisés que constituent les vieillards, les aveugles, en somme à tous les maudits et leurs taudis qui composent l’âme de la capitale. Le poète porte Paris dans son cœur, « pas le Paris des palais et des grandes places, mais le Paris des hôpitaux et des mendiants, des filles et des débauchés, le Paris des brouillards et des pluies, le Paris du malheur, de la souffrance, du vice ». Partout, on est frappé par l’image de la pauvreté qui devient de plus en plus le symbole du Spleen. Dans cette section des « Tableaux Parisiens », il s’agira essentiellement pour Baudelaire de parler de l’enlisement, de l’accablement et cette aspiration à une vie de dignité et de décence qui est, dans une ville moderne, la forme commune de l’idéal. Ce spectacle de la pauvreté devient progressivement le portrait de la tragédie de l’existence. Au sein de la ville, la pauvreté dépasse même une condition physique et se perçoit comme un état d’âme. C’est donc une contradiction bien flagrante qui est mise en évidence et qu’éprouve le poète et, par la même occasion, ses semblables. Ce qui retient notre attention, c’est ce sentiment d’incompatibilité et de différence entre les rythmes urbain et humain. Ce ressentiment, Baudelaire l’a bien exprimé lorsqu’il affirme :
Paris change !mais rien dans ma mélancolie
N’a bougé ! …
La Modernité met en exergue d’emblée « le propre de l’artiste moderne qui voit dans la grande ville non seulement la déchéance de l’homme mais aussi une beauté jusqu’alors inconnue ». Dès le début des « Tableaux Parisiens », avec le poème liminaire « Paysage », Baudelaire exprime sa fascination face à la grandeur et à l’animation de la ville ; allant même jusqu’à la voir comme une étendue d’eau :
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde ;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité.
Cependant, cette fascination sera de courte durée car il constatera que cet ennui qui lui a fait sentir le besoin d’aller vers l’autre ne fait que s’accroître. Dès sa sortie dans la rue, le poète pose son regard sur la couche marginale de la société, sans doute s’identifiant à elle. Dans la plupart des poèmes qui composent les « Tableaux Parisiens », Baudelaire nous parle des vieillards, des vieilles, des aveugles, des prostitués…, en les peignant de la manière la plus misérable qui soit. Ainsi « la misère du poète est en effet l’image de la misère universelle. Son drame intime prend sa véritable dimension dans la foule ; sa souffrance s’intègre à celle de tout un peuple ». Baudelaire, toujours dans son entreprise d’exprimer son regret du vieux Paris perdu à cause des travaux d’Haussmann et de l’énorme contradiction qui existe entre la morphologie de la ville et la situation des personnes qui y vivent, peint également Paris comme une ville de débauche et de criminalité. L’homme de la ville, à peine la nuit tombée, se métamorphose en « bête fauve » et s’attèle à des pratiques malsaines. Ainsi
La prostitution s’allume dans les rues ;
Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ;
Partout elle se fraye un occulte chemin,
Ainsi que l’ennemi qui tente un coup de main ;
Elle remue au sein de la cité de fange
Comme un ver qui dérobe à l’homme ce qu’il mange.
En effet, le poète met l’accent sur l’obscénité dans laquelle se trouve Paris en décrivant les premières heures dans les bordels. Baudelaire peint cet état de débauche dans le poème « Le Jeu » où il avoue se trouver face à un « noir tableau » que représente la ville de Paris. Cependant, cette passion démesurée et incontrôlable qui secoue l’homme le mène à sa perte et Baudelaire en est conscient, d’où le sens de ces vers :
Et mon cœur s’effraya d’envier maint pauvre homme
Courant avec ferveur à l’abîme béant
Devant cette pléthore d’horreurs, le poète ne trouve qu’un subterfuge, celui de se plonger dans un monde fantastique et de laisser libre cours à son imagination qui représente pour lui « la reine des facultés », afin d’atteindre son monde idyllique. Cependant, son retour à la réalité ne saurait tarder car :
En rouvrant mes yeux pleins de flamme
J’ai vu l’horreur de mon taudis,
Et senti, rentrant dans mon âme,
La pointe des soucis maudits ;
Baudelaire use donc de tous les moyens pour échapper à cet enfer qui est sa vie au quotidien. Mais, force est de constater que même si le monde « Idéal » auquel il aspire semble impossible à atteindre, Baudelaire laisse apparaitre une lueur d’espoir, exprimée dans le poème « Le Soleil »
Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Eveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir !
En somme, nous pouvons dire que la ville constitue pour Baudelaire un décor privilégié. Elle est le théâtre de toutes les souffrances et infamies humaines qui sont en contradiction totale avec le changement morphologique de la ville dû au plan d’Haussmann. Ce tableau macabre de la ville, peint par le poète, n’aurait pas pu retenir notre attention s’il n’avait pas fait recours à la peinture de la laideur. La laideur a longtemps été ignorée par les poètes parce qu’ils étaient convaincus qu’elle ne répondait pas à la conception qu’ils s’étaient faite de la poésie. Ayant pour finalité de produire du Beau (d’après la définition du mot), la poésie ne pouvait avoir pour muse que ce qui inspirait de la beauté. Sa source d’inspiration était principalement la nature, le soleil, la femme idéale…bref tout ce qui, d’une manière ou d’une autre revêt un certain mystère pour l’homme et qui renvoie à la beauté. Le beau a donc été la muse de nombreux poètes dans la poésie classique. Même si nous reconnaissons que la majeure partie des œuvres poétiques n’ont été inspirées à leur auteur que grâce à la contemplation du beau, le laid, à travers Baudelaire, est parvenu à s’imposer, allant même jusqu’à remettre en cause la nature même de la poésie. Avec Baudelaire, toutes ces considérations citées plus haut vont être remises en cause. Il va, à travers Les Fleurs du Mal, explorer le domaine du laid, du trivial pour en faire une matière poétique. La poésie ne s’assigne plus comme unique rôle de célébrer ce qui élève et ce qui est considéré comme beau, mais prend en compte, désormais, ce qui constitue la misère humaine dans toute sa banalité. « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », telle est l’affirmation de Baudelaire dans son Projet D’Épilogue pour la deuxième édition de son recueil. Ainsi, il médite sur le laid et sur la possibilité pour la poésie d’en faire de la beauté ; grâce aux mots, il est parvenu à extirper de cette laideur une véritable œuvre d’art reconnue par tous et à démontrer que la poésie peut clamer sa vérité face à toutes les impostures. De ce fait, le poète « viole les habitudes morales du lecteur » en décrivant une chair animale en pleine décomposition :
La puanteur était si forte, que sur l’herbe
Vous crûtes vous évanouir.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Cette pourriture, qui était censée ne contenir rien de « poétique », constitue aux yeux de Baudelaire une part de l’essence même de la beauté poétique. Ainsi, « Ces monstres disloqués », « Ombres ratatinées », « Débris d’humanité » qui peuplent l’univers urbain permettent au poète d’accentuer le degré de l’horreur de la souffrance humaine. Il ne se limite pas à décrire ce tableau macabre présent au sein de la cité, son regard perçant nous en impose une vision. Cependant, le poète ne reste pas inactif devant ce tableau piteux pour se limiter seulement à le décrire. Il use de l’imagination pour métamorphoser ce noir tableau car :
Et tout, même la couleur noire,
Semblait fourbi, clair, irisé ;
et fait transparaitre son idéal à travers la peinture du laid. Dès lors, en mettant l’accent sur ceux qui sont en marge de la société, Baudelaire exprime dans le poème « Rêve Parisien » ce qui constitue son « monde ». La laideur donne, pour ainsi dire, naissance à la beauté moderne qui est essentiellement morbide, scandaleuse, macabre. Ainsi à l’image de « La Muse Malade », l’inspiration du poète ne reflète que « la folie et l’horreur froides et taciturnes ». Toujours fidèle à son intention de se frayer son propre chemin en se faisant original sur le plan thématique, Baudelaire aborde un thème qui fera couler beaucoup d’encre et entrainera la condamnation du recueil. Lors du procès, Les Fleurs du Mal sont présentées comme le lieu par excellence où « l’odieux y coudoie l’ignoble ; le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages ; jamais on n’assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermine ». Ce thème s’avère être le mal et il constitue le cœur même de la poésie baudelairienne.
Une libéralisation du langage poétique
La langue de la poésie est une langue spéciale cherchant à se distinguer de la langue commune. Si l’on en croit la tradition classique, la poésie était un genre supérieur et disposait d’un vocabulaire spécial qui comprenait un petit nombre de mots dits « poétiques » et elle se distinguait de la prose par le nombre considérable de vocables interdits. Au début du siècle, comme l’a signalé Ferdinand Brunot, Le jargon de la poésie française était une langue morte. Non seulement les poètes n’osaient pas introduire dans leurs vers des mots que les prédécesseurs autorisés n’avaient pas employés, mais ils n’avaient pas le droit, sauf dans des cas exceptionnels, de former des alliances nouvelles, ni d’inventer des images neuves. La mort de ce jargon de la poésie française n’avait pas seulement été remarquée par Baudelaire. Victor Hugo l’a dénoncée en 1856 dans ses Contemplations avec sa « Réponse à un acte d’accusation » dans ces propos :
Je fis souffler un vent révolutionnaire.
Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.
Plus de mot sénateur ! plus de mot roturier.
Comme le dit Yves Bonnefoy, ce serait une absurdité « de demander à la linguistique les clefs des relations entre signifiants dans le texte, comme si la poésie n’était pas de mettre en question dans ce texte même ce que la langue l’efforce de mettre en place». Avec Baudelaire, à la suite d’Hugo, on assiste à la révolution de la langue poétique à travers une nouvelle esthétique. Non seulement il élargit le lexique poétique mais, à la différence du poète des Châtiments et aussi à la différence de Dante qui pense que « quand nous traitons des choses nécessaires à un état bienheureux, nous devons passer les démons sous silence, puisqu’ils ne voulurent point, dans leur perversité, attendre l’effet des soins pris par Dieu », son langage est caractérisé par une violence accrue, un sadisme écœurant. Dante se positionne comme un visionnaire, en déclarant cela des décennies auparavant la publication des Fleurs du Mal. Cependant pour Dante, la langue vulgaire désigne la langue à l’état primitif, la langue de notre enfance, « la langue que nous parlons sans aucune règle, imitant notre nourrice ». C’est dire alors que cette thèse qui assigne à la poésie comme procédant d’une langue spécifique a souvent été source de divergences entre les poètes. Détacher la thématique de l’esthétique baudelairienne reviendrait à trahir le sens même du recueil. L’histoire nous a démontré que toutes les révolutions littéraires ne se sont pas seulement limitées à subvertir les sujets ; pour parvenir à changer le cours de l’histoire littéraire, il faut opérer la subversion des mots et des formes par lesquels tout passe quand on est écrivain et particulièrement quand on est poète. Avec Baudelaire, on assiste à la mise en mal des formes vieilles, à l’invention d’une esthétique de la grimace, du macabre, du grotesque…l’utilisation massive de l’ironie et de la dérision. Toutes ces composantes concourent à nous orienter vers une prise de conscience de la naissance d’un nouveau type de poésie : la poésie moderne. En entreprenant d’écrire un recueil de poèmes en vers versifiés, Baudelaire se proposa d’extirper la poésie des confins de la convenance où l’avait enfermé l’école classique. Contrairement à celle-ci, la poésie moderne ne saurait se conformer à des règles établies depuis des siècles or, tel que l’a dit Chloé Laplantine, Si la langue est convention et institution, le langage poétique « échappe à la convention essentielle du discours », « c’est une langue que le poète est seul à parler, une langue qui n’est plus une convention collective, mais expression d’une expérience toute personnelle et unique. Cette langue n’est donc pas connue a priori : celui qui l’entend ou la lit (…) doit s’y conformer, l’apprendre et accéder par cet apprentissage à l’intenté du poète. Nous sommes tentés de dire alors que le langage poétique ne saurait être un répertoire spécifique de mots dans lequel le poète puise pour faire de la bonne poésie ; il procéderait plutôt de la spontanéité des sentiments du poète car le langage poétique vise à produire une adéquation de la langue avec cette unité profonde de l’être et du monde. Cette spontanéité n’est rien d’autre que l’époque contemporaine où nous assistons à un développement fulgurant des moyens techniques. De la tranquillité qui caractérisait la poésie classique (paix de l’âme, contemplation de la beauté de la nature), on passe, chez Baudelaire à un univers sonore comme en témoigne le premier vers du poème « Á Une Passante »: « La rue assourdissante autour de moi hurlait ». L’assourdissement des rues et l’introduction de certains mots appartenant au champ lexical des progrès techniques, par exemple dans le poème « Moesta et errabunda » : « Emporte-moi, wagon ! enlève-moi, frégate ! », (Ici notre attention porte sur l’emploi du mot Wagon qui traduit l’avènement du chemin de fer), reflètent respectivement une modernité historique et une poésie moderne. Signalons d’emblée que Baudelaire n’est pas « un créateur de néologismes », son mérite a été d’adapter sa poésie moderne à un lexique moderne. Avec la poésie baudelairienne le langage poétique se libéralise. Tous les mots, même ceux du langage quotidien, ont une charge poétique. Nous le remarquons dans les poèmes de la section «Tableaux Parisiens » où Baudelaire, en nous présentant un des plus banaux tableaux de la capitale, utilise un langage familier. Dans le poème « Á Une Passante », le poète, pour décrire la pollution sonore de la ville et le caractère furtif de sa rencontre avec la femme, fait usage d’un langage clair, dépourvu d’énigmes et assez proche de la prose :
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston de l’ourlet ;
[…]
Un éclair…puis la nuit !- Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus dans l’éternité ? »
Sa poésie est caractérisée par un langage vulgaire, cruel qui engendre des images brutales et provocantes :
Cette femme, morceau vraiment miraculeux,
Divinement robuste, adorablement mince,
Est faite pour trôner sur des lits somptueux,
Et charmer les loisirs d’un pontife ou d’un prince
En effet, la poésie baudelairienne est riche en images ; son originalité résiderait dans la puissance des images qu’il impose à l’esprit ; sa description des phénomènes quotidiens a un but bien défini : celui de donner une nette perception de la réalité. Sa poésie, « sinistre et violente, déchirante et meurtrière dont rien n’approche dans les plus noirs ouvrages de ce temps » alla d’ailleurs parfois assez loin dans cette direction au point de heurter le public au goût conventionnel. Cette intensité de l’image se perçoit grâce à l’omniprésence de la figure de l’allégorie dans la poésie baudelairienne. Cela lui vaudra d’être considéré comme le chef de file du mouvement symboliste. Baudelaire est réaliste « dans ses descriptions de Paris, des foules, des tripots, des lieux publics, dans ses scènes d’érotisme sordide » Et cela lui a valu un procès car comme l’a souligné M. Pinard lors du procès, Son principe, sa théorie, c’est de tout peindre, c’est de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes ; il aura, pour la rendre, des tons vigoureux et saisissants, il l’exagérera surtout dans ses côtés hideux ; il la grossira outre mesure, afin de créer l’impression, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie (sic) du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n’obéit qu’à des règles artificielles. D’emblée, le poète assigne à la poésie un rôle neutre : celui de ne s’assujettir à aucune morale ou à une fausse pudeur d’une société hypocrite sous peine de perdre son originalité. Pour lui « l’amour de l’obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l’homme que l’amour de soimême, ne laissera pas s’échapper une si belle occasion de se satisfaire ». La poésie devient ainsi le truchement par lequel le poète passe pour extérioriser ses désirs les plus refoulés. Du titre du recueil « Les Fleurs du Mal » à l’esthétique, en passant par la thématique, aucun aspect n’échappe à la révolution. Pour Baudelaire, il existerait une matière jusque-là ignorée des poètes qui proviendrait des ignominies de l’existence des êtres humains et qui deviendrait, grâce à la poésie, une beauté neuve. Avant même d’aborder le contenu du recueil, l’évocation du titre nous laisse naturellement présager la nature du type de langage qu’emploierait le poète (spécifiquement le langage du mal). La vulgarité de la poésie de Baudelaire se perçoit dès l’entame du recueil avec le poème liminaire « Au Lecteur » où le poète dévoile le caractère pervers et sournois de l’être humain avec une violence langagière qui heurte la morale :
Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d’une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.
Cette perversité du langage Baudelairien atteint son paroxysme dans ses journaux intimes « Mon cœur mis à nu », « Fusées », où le poète ne se défend d’utiliser aucun mot. Dans ce dernier, le poète décrit sans voile les circonstances de l’acte sexuel : Entendez-vous ces soupirs, préludes d’une tragédie de déshonneur, ces gémissements, ces cris, ces râles ? Qui ne les a proférés, qui ne les a irrésistiblement extorqués ?et que trouvezvous de pire dans la question appliquée par de soigneux tortionnaires ?Ces yeux de somnambules révulsés, ces membres dont les muscles jaillissent et se roidissent comme sous l’action d’une pile galvanique, l’ivresse, le délire, l’opium, dans leur plus furieux résultats ne vous en donneront certes pas d’aussi affreux, d’aussi curieux exemples.Chez Baudelaire, de la même façon que tous les thèmes peuvent produire de la bonne poésie, tous les mots peuvent revêtir une charge poétique. Dès l’instant qu’on approuve le titre et qu’on soit conscient du tempérament du poète, de sa conception de la poésie, on doit être en mesure d’accepter que la poésie ne puise plus dans les sujets consacrés – et même peut être qu’elle ait plus de sujets consacrés du tout ; on admet qu’instrument d’exploration du monde, elle revendique le droit de tout peindre et de tout dire, de franchir toutes les limites et de violer tous les tabous, le droit de nommer ce qui ne l’avait jamais encore été et notamment ce « mal » qui doit d’abord sans doute se comprendre comme tout ce que le bon sens et le sens commun désignent ainsi :ce qui transgresse les normes(sociales, morales, religieuses), l’érotisme et sensualité, la débauche et l’orgie, le blasphème et la révolte, la fascination morbide et complaisante pour la souffrance (celle du moi, celle des autres) et pour la mort. Baudelaire cultive le sadisme tout au long de son recueil. Son langage sadique est indéniable et son univers poétique est caractérisé par une violence accrue mêlée de larmes, de sang et d’appétits charnels. Ce sadisme, cette perversité de la poésie de Baudelaire est à mettre en corrélation avec l’amour. En effet, chez le poète, c’est dans l’acte même de l’amour que « gît le mal » et à sa question qu’est-ce- que l’amour il répond :
Le besoin de sortir de soi.
L’homme est animal adorateur.
Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer.
Aussi tout amour est-il prostitution.
Et l’expression de ce mal ne saurait passer outre ce langage vulgaire. De « sed non satiata », Hélas ! et je ne puis, Mégère libertine, Pour briser ton courage et te mettre aux abois,
Dans l’enfer de ton lit devenir Proserpine,
Au « LETHE »
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants
Dans l’épaisseur de ta crinière lourde
Dans tes jupons remplis de ton parfum
Ensevelir ma tête endolorie,
En passant par « Les Bijoux »
La très chère était nue, et, connaissant mon cœur,
Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores,
[…]
Elle était donc couchée et se laissait aimer,
Et du haut du divan, elle souriait d’aise
A mon amour profond et doux comme la mer
Qui vers elle montait comme vers sa falaise,
Pour n’en citer que ces trois, il y a une omniprésence de la cruauté dans le langage de Baudelaire qui prend sa source dans l’amour et est simultanément un témoignage de la condition humaine. Face à la violence de ce sentiment, la férocité et l’agressivité demeurent la seule issue pour extérioriser et exprimer sa conception poétique. En plus de l’emploi de mots vulgaires, d’un ton sadique, d’images brutales heurtant la sensibilité, Baudelaire fait recours à d’autres techniques d’expression qui expriment la violence et qui sont devenues la marque de l’esthétique symboliste. Il s’agit des interrogations, des exclamations, de l’apostrophe qui traduisent dans une certaine mesure « la violence des passions, des émotions, et les états d’âme d’un être en face du monde […] et désignant la déchirure et l’indécision d’êtres en proie à je ne sais quelle angoisse diffuse ». Beaucoup de critiques comme Jean Paul Sartre ont voulu voir dans cette manière de faire de la poésie chez Baudelaire, une hystérie, une immanence de la vie du poète sans chercher à transcender l’au-delà de ce langage vulgaire et cruel. Contrairement à ceux-là, John E Jackson a su aller chercher au-delà des mots une lumière, un spiritualisme qu’on ne peut apprécier que dans des situations d’existence. Baudelaire, toujours fidèle à sa perspective de révolutionner la poésie française, introduit dans sa poésie une polyphonie énonciative qui crée un écho sonore dans le recueil. Ce constat nous amènera à étudier de plus près ce concept encore très récent et de voir comment et dans quelles perspectives le poète en fait recours dans Les Fleurs du Mal.
Les Fleurs du Mal : Une structure travaillée
La poésie, par essence, est un genre qui n’obéit à aucune trame narrative contrairement au genre romanesque dont la lecture fait prendre conscience au lecteur qu’il est en présence d’une succession de faits, d’un déroulement linéaire où l’ordre des chapitres ne saurait être indifférent. Depuis la naissance de la poésie jusqu’à nos jours une multitude de recueils poétiques nous est parvenue et ces recueils nous ont habitué à être en contact avec une compilation de poèmes composés au gré des fantasmes et de l’inspiration des poètes. Le plus souvent ces poèmes sont produits à des périodes différentes. Ce constat est en parfaite connivence avec la définition du mot recueil : « ouvrage ou volume réunissant des écrits, des documents ; assemblage ou réunion »(Le Grand Robert). Dès lors, il n’existait aucune relation, aucune suite logique entre les poèmes ou entre les différentes parties qui composent le recueil. La compréhension d’un poème ne nécessite guère la compréhension du poème précédent ou du suivant. Aucune modification, aucun changement de position ne saurait altérer ou trahir le sens du recueil. On peut procéder à une lecture indépendante ou hasardeuse. Á l’image d’un album, on passe d’un poème à un autre sans qu’il ait forcément un lien, ni un même sujet, encore moins un thème identique. Cependant, la modernité poétique de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, laisse entrevoir une architecture dont il serait une erreur de négliger. En effet, cette « architecture secrète », dira Barbey D’Aurevilly, Baudelaire le certifie à Vigny dans une lettre en 1861 en ces termes : « Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu’on reconnaisse qu’il n’est pas un pur album et qu’il a un commencement et une fin. Tous les poèmes nouveaux ont été faits pour être adaptés à un cadre singulier que j’avais choisi ». En véritable alchimiste, Baudelaire s’est attaché à se conformer à un schéma bien précis, sans doute dans le but de demeurer fidèle à sa conception de la beauté car, pour lui, celle-ci ne peut résulter que du calcul. Dès l’entame du recueil, avec le poème « Bénédiction », le poète, après s’être fait rejeté dès sa naissance par sa mère, dit :
Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,
Le Poète apparait en ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié :
– « Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères,
Plutôt que de nourrir cette dérision !
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon expiation !,
Il se voit, incompris par ses semblables dans « L’Albatros » parce que considéré en Prince des nuées, exilé sur le sol au milieu des huées. Á cause de cette posture de Prince des nuées, le poète exprime son désir de s’envoler par l’esprit dans « Élévation » et cela lui permettra de déchiffrer les signes imperceptibles à ses contemporains. Tel est ce dont il est question dans le poème « Correspondances ». Nous pouvons constater que dans ces extraits de poèmes cités ci-dessus, le dénominateur commun reste le poète. Il est question de sa situation, de son appréhension de la part de ses contemporains vis-à-vis de sa fonction de poète. Il y a là une progression logique de la « trame poétique » qui part du rejet de la mère à celui des hommes, dû à son statut de créateur. Ce constat conforte l’idée selon laquelle on n’est plus devant des bribes de poèmes amassés çà et là, mais en face d’une structure travaillée, d’une disposition réfléchie qui, à la suite des poèmes, fait appel à une mise en relation des différentes parties. Aucune pièce citée, comme l’affirme Barbey D’Aurevilly :
N’aurait que sa valeur individuelle, et il ne faut pas s’y méprendre, dans ce livre de M. Baudelaire, chaque poésie a, de plus que la réussite des détails ou la fortune de pensée, une valeur très importante d’ensemble et de situation qu’il ne faut pas lui faire perdre, en la détachant. Les artistes qui voient les lignes sous le luxe et l’efflorescence de la couleur percevront très-bien qu’il y a ici une architecture secrète, un plan calculé par le poète, méditatif et volontaire. La disposition de ses poèmes revêt une importance capitale chez le poète. Cet attachement à son architecture lui a valu, lors de la censure de la première édition en 1857, lorsqu’il était contraint de retrancher cinq de ses poèmes, de reprendre l’intégralité du recueil par soucis de réorganisation. Ce réaménagement a donné naissance à l’édition de 1861 sur laquelle nous nous fondons pour notre étude et qui a vu l’introduction de trente-six nouveaux poèmes et une nouvelle section : les Tableaux Parisiens. De cinq parties en 1857, on passe à six en 1861. Nous essayerons d’analyser cette architecture autant entre les poèmes qu’entre les sections. En parcourant Les Fleurs du Mal, tout comme l’a remarqué D’Aurevilly au niveau des parties, nous avons eu à déceler une progression entre les poèmes. La lecture de la chute du poème fait résonnance au poème suivant. Il y a une sorte d’écho qui donne l’impression au lecteur, dès l’abord du poème suivant, qu’il est dans une continuité. Ainsi de la fin de « La muse vénale » où l’énonciateur compare sa situation avec celle d’un enfant de cœur à qui il dit :
Il te faut, pour gagner ton pain de chaque soir,
Comme un enfant de cœur, jouer de l’encensoir,
Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois guère,
Fait suite « Le mauvais moine » qui continue toujours sur la même lancée en restant sur le même registre, celui de l’univers religieux.
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles
Etalaient en tableaux la sainte Vérité,
Dont l’effet, réchauffant les pieuses entrailles,
Tempérait la froideur de leur austérité.
C’est donc témoigner de la véracité des propos de Baudelaire sur l’importance de la disposition des poèmes qui traduit l’expression d’une Modernité sur le plan formel. « Ce plan calculé par le poète, méditatif et volontaire » serait l’expression de l’ennui et de l’angoisse de l’homme moderne, tiraillé par le désir d’atteindre l’idéal, la pureté mais qui succombe à l’attraction du gouffre (Spleen et l’Idéal). Il va à la rencontre de l’autre dans les « Parisiens » et constate une atmosphère, un décor les plus modiques où l’être humain vit dans la plus grande misère en parfaite contradiction avec la métamorphose qui s’opère dans la ville sur le plan architectural, attestant la modernité, et cela accroit plus son Spleen. Devant cette impuissance d’accéder à l’idéal et ce tableau macabre que constitue la ville, le poète se réfugie dans l’alcool à travers la section « Le vin » pour s’enivrer afin d’échapper à la conscience du temps qui s’écoule et du caractère misérable de la vie à Paris. Il se libère en chantant les bienfaits passagers de l’ivresse (son espérance d’une vie meilleure). Face à l’inefficacité du vin, le voilà plongé dans les paradis artificiels dans la section éponyme du recueil «Les Fleurs du Mal » où l’amour est vécu d’une manière obscène et dépravée. Il dénonce le caractère pervers et satanique de la volupté, sa liaison indescriptible avec le mal et la douleur, l’absurdité de la vie et la puissance de Satan atteignant son paroxysme, il se livre au blasphème à travers la section « Révolte », ce qui aboutit à la Mort qui clôt le recueil et le délivre de sa souffrance d’où cette exhortation qui clôt également le recueil :
O Mort, vieux capitaine, il est temps !levons l’ancre !
Ce pays nous ennuie, o Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme l’encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons
Le poème voyage résume parfaitement cette succession des sections en montrant l’aboutissement de la vie terrestre qui bute sur l’ennui, se complaint dans le vin et l’amour source de débauche, se livre à la révolte et retrouve une fin salvatrice dans la mort.
L’humanité bavarde, ivre de son génie,
Et, folle maintenant comme elle était jadis
Criant vers Dieu, dans sa furibonde agonie :
Ô mon semblable, ô mon maitre, je te maudis !
Et les moins sots, hardis amant de la Démence,
Fuyant le grand troupeau parqué par le destin,
Et se réfugiant dans l’opium immense !
– Tel est du globe entier l’éternel bulletin.
Cependant, cette succession des parties dans le recueil ne saurait être rattachée simplement à un besoin impérieux d’exprimer l’angoisse de l’homme moderne. En effet, la composition des Fleurs du Mal revêt également un symbolisme au plan du contexte de publication. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXème siècle où chaque nouvelle publication d’œuvre littéraire est rangée, soit chez les romantiques soit chez les parnassiens, selon que l’accent est mis sur l’expression des sentiments ou sur le travail formel. Loin de subir l’influence aveugle de ces dernières, Baudelaire se forge une nouvelle technique de composition poétique qui fait appel à la logique inaugurant ainsi une nouvelle démarche en lien avec les tiraillements de l’homme moderne. Le travail de la forme devient un moyen de guérir une souffrance que l’homme moderne ne cesse d’éprouver : le salut ne peut être trouvé que dans le langage. Pour Baudelaire, la beauté est le résultat de la raison et du calcul, d’où la suprématie de l’artificiel sur le naturel. Toujours dans son entreprise à prendre en considération les aspirations de son époque, c’est-à dire le transitoire, Baudelaire accorde une place primordiale à la peinture. Il nous a paru donc important de nous intéresser à cette question qui nous permettra d’expliciter ce qui fait la modernité baudelairienne. Pour y parvenir, nous ferons appel au concept de l’intertextualité qui nous aidera à expliquer et à analyser cette immersion de la peinture dans la poésie moderne baudelairienne que constituent Les Fleurs du Mal.
|
Table des matières
INTRODUCTION
Première partie : la modernité thématique dans Les Fleurs du Mal
Chapitre I : Le contexte de publication
Chapitre II : Une thématique du gouffre
Deuxième partie : La modernité esthétique dans Les Fleurs du Mal
Chapitre III : Un style hybride
Chapitre IV : L’art moderne : une technique d’écriture
Conclusion
Télécharger le rapport complet