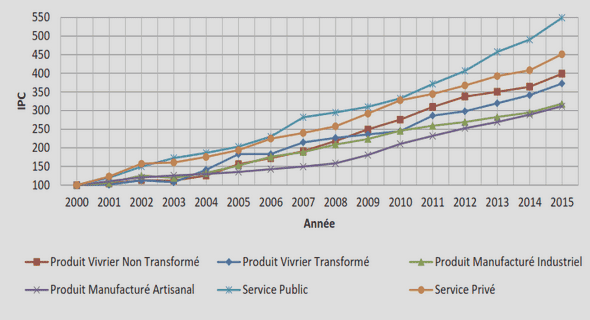L’organisation en amont
Pour mieux cerner les raisons qui poussent les Européens à collecter les végétaux, il est utile de comprendre d’abord les objectifs premiers de l’exploration, particulièrement dans les mers du Pacifique Sud. Des mythes impliquant des paradis spirituels autant que des théories scientifiques aux ambitions coloniales, Anglais et Français espèrent trouver, dans le Pacifique comme dans d’autres régions du globe jusque-là encore mal connues, de nouvelles opportunités commerciales, agricoles et territoriales, qui les poussent à former officiers et savants dans le but de combler les blancs de la carte et de faire l’inventaire de la nature à l’échelle mondiale. Ils rédigent aussi des instructions pour guider les voyageurs sur les océans comme dans les différents aspects de leur travail.
Les objectifs de l’exploration du Pacifique sud
Plusieurs éléments peuvent expliquer les raisons qui poussent les gouvernements européens du second XVIIIe siècle à envoyer des hommes risquer leur vie à l’autre bout du monde. D’abord, la volonté de « repousser les limites du monde connu » pour vérifier les mythes, comme celui lié à Tombouctou ou au continent austral. La seconde raison est la volonté de conquérir de nouvelles terres et d’accroître les connaissances scientifiques et les richesses à exploiter dans un contexte colonial.
Pour Philippe Bachimon, l’exploration et la géographie sont motivées par le mythe.
Il évoque ainsi le lien entre les mythes du jardin d’Éden et du prêtre Jean et l’exploration de l’Afrique sub-saharienne (Soudan, Éthiopie), entre les mythes du « bon sauvage » et du continent austral et l’exploration du Pacifique, la Polynésie étant longtemps considérée comme la partie émergée d’une « nouvelle Atlantide ».
La difficulté de pénétrer dans l’océan Pacifique aurait suffit à le rendre mythique. (…) Outre la difficulté d’y pénétrer qui en fait un espace sacré, interdit au commun des mortels, réservé aux téméraires, aux audacieux, son immensité l’éloigne des échelles humaines pour le rapprocher de l’infiniment grand. (…) Cette immensité marine semblait si inconcevable que les savants la restreignirent par l’hypothèse d’un continent austral.
En effet, depuis l’Antiquité, la croyance en une Terra australis censée contrebalancer au sud de l’équateur le poids des continents de l’hémisphère nord est largement répandue.
On peut la retrouver dans les mappemondes européennes dès le début de la Renaissance.
En 1515, le cartographe et géographe allemand Johann Schöner réalise une mappemonde montrant un continent au sud du détroit de Magellan qu’il nomme Brasilia inferior. Il reprend ce travail qu’il approfondit dans une nouvelle mappemonde en 1520 (figure 1). Cette Terra Australis est située au niveau du détroit de Magellan. Même si l’emplacement géographique est loin d’être précis, les contours rappellent ceux de l’Australie, tout comme les arbres qui y sont dessinés.
En 1587, Rumold Mercator publie un planisphère sur lequel figure une Terre Australis immense, dont les contours reprennent ceux déjà connus de l’Australie, lié à un continent antarctique supposé. (figure 2).
En 1642, le Hollandais Abel Tasman est le premier Européen à découvrir les côtes de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie. À partir de cette découverte, on considère ces terres comment faisant partie de ce gigantesque continent austral.
Les voyages de James Cook (1728-1779) et de Matthew Flinders (1774-1814) résolvent finalement la question de la Terra Australis à la fin du XVIIIe siècle. Flinders fait en effet le tour de l’Australie, et Cook de la Nouvelle-Zélande, prouvant respectivement qu’elles ne pouvaient pas faire partie d’un continent plus grand. Lors de son second voyage, Cook réalise un tour de la Terre à de très hautes latitudes Sud, traversant parfois même le cercle polaire, démontrant ainsi que le continent méridional, s’il existe, ne peut se trouver que dans la région polaire, et est donc forcément beaucoup moins grand que ce qu’on a cru jusqu’à présent.
Le voyage dans le Pacifique sud résulterait donc d’abord de ce désir de repousser les limites du monde connu et de vérifier les mythes et les théories savantes. Cependant, même une fois le problème du continent austral résolu, un autre élément, déjà présent depuis le début de ces expéditions, guide les Européens dans cette région du globe.
La France et la Grande-Bretagne sont des pôles de croissance économique, notamment grâce au négoce atlantique (commerce triangulaire) qui permet la croissance des ports, et à l’industrialisation qui commence déjà à se mettre en place. Cela paraît donc tout à fait logique que ce soit ces deux puissances économiques qui partent explorer de nouveaux territoires, suite au renouvellement de l’intérêt pour les régions inconnues comme le Pacifique dû au tour du monde de l’Anglais George Anson (1740-1744). Celuici s’empare des documents cartographiques espagnols confidentiels, ce qui permet la levée progressive du secret sur les découvertes et le début des voyages scientifiques ; ceci couplé à la publication rapide des résultats permet la progression des connaissances scientifiques.
Le second XVIIIe siècle voit aussi la France essayer de compenser la perte de ses possessions en Amérique du Nord et en Inde face à la Grande-Bretagne, suite à la guerre de Sept ans , terminée en 1763, et qui avait mis en pause les ambitions de découvertes.
Les îles paradisiaques (comme la « Nouvelle-Cythère » de Bougainville) laissent espérer de nouvelles richesses à exploiter, et le contexte de compétition commerciale et coloniale pousse ces deux puissances à faire une « course à l’inventaire » des ressources utiles du monde, un véritable « catalogue de la nature ».
Jusqu’alors seuls membres scientifiques embarqués dans les expéditions de découverte, les astronomes laissent progressivement la place aux naturalistes, qui sont systématiquement envoyés dans les grandes expéditions d’exploration du second XVIIIème siècle L’histoire naturelle devient alors le premier argument de l’exploration, avec la géographie, l’ethnologie, l’archéologie, la géologie, etc.
Le projet utilitaire du voyage semble être à l’origine des grandes découvertes, et la science se met au service de la conquête européenne dans toutes les régions du monde, et notamment dans le Pacifique Sud.
La réalisation de ces deux objectifs – la vérification du mythe du continent austral et la tentative de faire un inventaire des ressources à exploiter dans le monde – est facilitée par l’amélioration des techniques de navigation. En effet, le plus gros obstacle qui gène l’exploration du Pacifique sud est la présence de vents et de courants qui emportent les navires vers l’équateur. De plus, les explorateurs ne peuvent pas se permettre de voyager dans l’immensité de cet océan sans savoir s’ils vont rencontrer une terre où se ravitailler en eau et en nourriture fraîche.
Cependant, l’amélioration de la cartographie (souvent liée aux expéditions militaires), les progrès techniques de la navigation et des conditions sanitaires, permettent aux voyageurs de se lancer dans l’inconnu avec plus de sécurité.
Tout particulièrement, la création en 1765 à Paris de la première école de formation d’ingénieurs es construction navale permet l’amélioration de l’endurance des navires, tandis que le calcul de la longitude (qui permet de se situer dans l’espace, de faire des cartes plus précises) est rendu beaucoup juste grâce au calcul par les distances lunaires et à la mise au point du chronomètre.
De plus, la participation accrue voire systématique des institutions gouvernementales et scientifiques permet la formation maritime et scientifique des officiers à qui l’on donne des instructions de voyage, tout en permettant l’embarquement de savants spécialistes.
La formation et les instructions de voyage
L’amélioration des conditions de navigation et de découvertes passe donc aussi par la formation des officiers et des savants qui embarquent pour les voyages au long cours. Les officiers de marine suivent des formations scientifiques ; le navigateur est à la fois marin et savant, souvent membre d’une académie.
Évidemment, le capitaine reçoit aussi des instructions pour guider son voyage, lui donner les objectifs de son expédition. Prenons l’exemple des instructions de voyage de Bougainville. Celui-ci rédige lui-même un premier projet des instructions qui doivent lui être prescrites par le ministre de la Marine, instructions dont la version finale est signée par le roi le 26 octobre 1766 sous le titre de Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur de Bougainville, colonel d’infanterie et capitaine de vaisseau pour la campagne sur les opérations qu’il va faire.
Le premier paragraphe est consacré à la cession des Malouines [Falkland] aux autorités espagnoles, la raison officielle et première de l’expédition. Ensuite, les instructions évoquent les terres à découvrir.
« Marins contre botanistes »
L’inadéquation entre les objectifs de l’expédition et de ses chefs (exploration, temps long passé en mer pour découvrir un maximum de surface), et les envies des naturalistes (besoin d’escales longues pour prendre le temps de recueillir et d’étudier) est évidente.
Voyager, explorer, collecter, sont tout le contraire d’étudier, qui nécessite des escales importantes, et des moyens suffisant pour analyser les données recueillies.
La place nécessaire aux savants, et plus particulièrement aux naturalistes, est de la place en moins pour des marchandises, du ravitaillement ou même pour le confort de l’équipage. Les botanistes et zoologistes se munissent de nombreux outils de récolte des spécimens (cisailles, hameçons, filets, fusils, …), de matériel de conservation, mais aussi d’importantes bibliothèques qui servent à reconnaître les produits naturels, comme on l’a déjà vu. Enfin, les collections emballées prennent énormément de place, qui rogne sur l’espace libre déjà restreint des navires. On comprend donc que l’équipage soit hostile à la présence d’une grande équipe scientifique.
Même si « l’entente de Cook et de Banks [est] excellente, prouvant qu’une harmonie totale [est] possible entre civils-scientifiques et marins-explorateurs » lors de la première expédition de 1768-1771, les exigences de Banks en matière d’équipe et de matériel le voient se faire refuser une place dans la deuxième expédition par l’Amirauté.
Il est donc remplacé, à la demande de la Royal Society, par l’allemand Johann Reinhold Forster et son fils Georg, mais la cohabitation est catastrophique, ce qui fait que la troisième expédition de prévoit pas d’équipe scientifique. Chaque voyage de Cook nous montre donc un aspect différent des rapports entre officiers et savants.
Les deux partis se gênent facilement l’un l’autre : l’expédition de d’Entrecasteaux est retardée de plusieurs jours à son départ de la baie de l’Espérance [sur la côte de l’Australie-Occidentale] par le naturaliste Claude Antoine Gaspard Riche, perdu à terre pendant qu’il récoltait des spécimens d’histoire naturelle. Contrairement aux souhaits de La Billardière de faire escale à la Nouvelle-Zélande pour récupérer une plante à ramener en Europe, l’expédition continue sa route.
Cependant je crus de mon devoir de lui exposer combien il serait important de prendre à la Nouvelle-Zélande la plante liliacée connue sous le nom de phormium tenax (le lin de la Nouvelle-Zélande), pour la transporter en Europe, où elle réussirait parfaitement. Les fils qu’on retire de ses feuilles ont une force bien supérieure à toutes les autres productions végétales qui sont employées à faire des cordes ; les câbles qu’on pourrait en fabriquer résisteraient aux plus grands efforts. Personne n’eût dû apprécier mieux que le Commandant de notre expédition toute l’utilité de cette plante pour notre marine.
La collecte et le transport des produits naturels
À présent que nous avons vu les préparatifs des expéditions et cerné les difficultés du voyage au long cours dans le Pacifique sud dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il est temps de nous concentrer sur la récolte de la nature, ainsi que sur les conditions de transports de spécimens vers la métropole et vers l’île de France, qui sert d’étape à l’acclimatation de la plupart des plantes.
La récolte, la conservation et le transport des plantes vivantes
Les naturalistes se munissent évidemment d’équipements de conservation et de récolte, mais d’abord d’une vaste bibliothèque, composée d’ouvrages théoriques (comme le Systema Naturae de Linné ou le Genera Plantarum d’Antoine-Laurent de Jussieu), d’inventaires de la flore ou de la faune d’une région, et de récits de voyage.
A l’instar de leurs prédécesseurs, les voyageurs du XVIIIe siècle s’appuyaient sur les auteurs anciens afin d’identifier les différentes plantes.
Avoir accès à ces ouvrages permet aux savants de se donner un cadre descriptif commun, qui leur donne la possibilité de reconnaître les espèces ou de les définir comme nouvelles. De plus, on considère qu’un naturaliste averti peut reconnaître en terrain inconnu une plante dangereuse ou bonne à manger, ou à soigner, à partir de ce qu’il connaît déjà.
Qu’on n’en doute pas ! Un coup d’œil expérimenté suffit pour prononcer dans un pays tout à fait inconnu : c’est ici un fruit mangeable… là un légume bon à cuire… là une semence farineuse propre à faire du pain… ici ce sera un remède congénère à tel autre déjà connu… là enfin un poison funeste dont il faut retirer la main.
Aux compétences de collecteur du naturaliste doivent s’ajouter toutes sortes de « connaissances spéciales » et de « savoirs techniques particuliers » : il doit être tour à tour “géologue, chimiste, historien, botaniste, physicien, zoologue, paléontologue, météorologue, astronome, etc. » , compétences nécessaires pour le travail titanesque et polyvalent qui est demandé au savant.
Les plantes sont de préférence récoltées et transportées vivantes, mais les naturalistes ont aussi souvent recours aux graines, qui sont plus faciles à acclimater ailleurs, ainsi qu’à des échantillons d’écorce, de feuilles, de fruits, etc.
Dans les deux cas, fruitiers atlantiques ou fruitiers exotiques, le succès ne tenait pas aux pieds ou aux boutures importées, mais aux graines apportées. Les graines étaient séchées dans un sac de toile quand elles n’étaient pas protégées par une chair.
Le second XVIIIe siècle voit apparaître les premiers guides de collecte, de conservation et de livraison des produits naturels. En 1752, Duhamel du Monceau, botaniste et agronome, et Rolland-Michel Barrin de La Galissonnière, gouverneur de la Nouvelle-France [Amérique du nord française], rédigent le premier ouvrage français sur le transport par mer des végétaux, l’Avis pour le transport par mer, des arbres, des plantes vivaces, des semences & de diverses aux curiosités d’histoire naturelle. Ce texte est une annexe du Mémoire instructif sur la manière de rassembler, de préparer et d’envoyer diverses curiosités d’histoire naturelle du chevalier Étienne-François Turgot (1758).
L’Instruction pour les voyageurs et pour les employés dans les colonies, dont on a déjà parlé, fait elle aussi partie de ces ouvrages, en donnant des méthodes pour la conservation et l’emballages des curiosités d’histoire naturelle à destination du Muséum.
Les méthodes sont cependant loin d’être suivies à l’unanimité ; il existe presque autant de procédures que de naturalistes, et ceux-ci échangent énormément sur les différentes techniques, comme nous le verrons plus tard. Il faut inventer sans cesse des solutions pour résoudre le manque d’eau à bord ou le problème des prédateurs (insectes, rats), pour éviter les pertes au maximum. Par exemple, dans les îles des Amis, les deux cent plants d’arbres à pain (figure 8) choisis par La Billardière et Delahaye pour être rapportés à l’île de France par l’expédition de d’Entrecasteaux sont conditionnés dans des caisses rectangulaires en bois dotées de trous pour le drainage et d’un cadre en verre et en grillage pour la régulation de la température.
Chacun y va de son conseil, et des recommandations variées sont données pour le transport et la conservation des graines pendant le voyage de leur lieu d’origine à celui d’implantation. Les graines sont transportées en caisse, en plateau ou en flacon et, parfois, incorporées à une couche de terre fraîche, ; elles peuvent donc arriver déjà germées. Les plantules et les semences des différentes espèces ne réclament pas la même ventilation, le même arrosage et le même taux de lumière, ce qui ajoute au côté complexe du transport des plantes vivantes. On développe des boîtes de transports vitrées et/ou grillagées, des serres adaptées au voyage sur un navire…
La recherche de plantes et la nécessité de les transporter de pars le monde a sans conteste servi au développement de la botanique et des techniques de conservation, de transport et d’acclimatation des végétaux.
Face aux dangers encourus dans les terres lors des herborisations et des cueillettes, les naturalistes évitent de rester seuls. Ainsi, lors de son voyage à la Nouvelle-Guinée, Pierre Sonnerat se fait accompagner de « six Indiens et d’un Interprète », pour éviter d’être attaqué par les peuples hostiles de l’île, ou, au pire, pour pouvoir se défendre.
La nature dématérialisée
Afin de ne pas perdre d’informations, il est nécessaire pour les naturalistes de faire preuve de rigueur et de méthode pour l’enregistrement des données. Cela consiste non seulement en la récolte de plantes vivantes, mais aussi de graines et d’échantillons, ainsi qu’en la réalisation d’herbiers, de descriptions textuelles et de croquis. Cette dématérialisation permet un gain de place mais aussi la possibilité d’étudier au cabinet les espèces qu’on ne peut pas transporter.
Les graines sont couramment récoltées de préférence à la plante vivante. En effet, il est plus facile de les naturaliser (i.e. conférer un nouvel habitat à la plante) sous cette forme, qu’un plant déjà grand, qui aura plus de mal à s’habituer au climat. Elles sont aussi plus faciles à transporter, puisqu’elles prennent peu de place et de ressources (si le jardinier fait en sorte que la graine ne retrouve pas les conditions requises pour déclencher sa croissance, en la séchant par exemple).
Les semences sont ainsi idéales pour être envoyées dans une simple enveloppe, ce qui est utile pour la dispersion des nouvelles espèces par voie postale. Les naturalistes, agronomes et jardins botaniques ont énormément recours à ce procédé, s’échangent les doublons comme les enfants le font aujourd’hui avec leurs cartes Pokémon, et diffusent ainsi les espèces tout juste découvertes et ramenées d’Europe.
Dans le cas des herbiers, chaque spécimen est accompagné d’une étiquette indiquant le voyage ou la région, si ce n’est la zone précise de la récolte, et le nom du collecteur, « détails » qui ne sont pas toujours mentionnés, ainsi que le nom présumé de la plante.
Ces indications sont placées au moment de la collecte, ou dans un temps court la suivant, de retour à bord du navire par exemple. Ensuite, la classification est vérifiée par les savants chargés d’étudier l’herbier au retour de celui-ci en France et de corriger les erreurs.
Les collections de l’expédition Baudin rejoignent la France en deux temps : d’abord à bord du Naturaliste, qui ramène en juin 1803 douze caisses de plantes séchées, c’est-àdire toutes celles réunies avant l’arrivée à Port Jackson, où les deux navires se sont séparés. Le Géographe rentre en France en mars 1804, avec à son bord six nouvelles caisses. L’herbier est déposé au Muséum national d’histoire naturelle et l’ensemble reste intouché après avoir été intégré à l’herbier général du Muséum, quoique certaines parties sont étudiées dès son arrivée en France. Au total, l’herbier de l’expédition Baudin contient près de deux mille cinq cent spécimens, pour la plupart récoltés dans les alentours de Port Jackson, de Kupang à Timor, du détroit d’Entrecasteaux en Tasmanie et de King George Sound [aujourd’hui Albany, sur la côte de l’Australie-Occidentale].
Pour faciliter l’aspect illustratif de leur travail, les naturalistes se font accompagner par des dessinateurs et des peintres, comme nous l’avons vu un peu plus haut en évoquant la composition des équipes scientifiques. Les expéditions comptent presque toujours un peintre officiel, chargé de représenter les paysages et les indigènes observés, et souvent un voire plusieurs dessinateurs naturalistes. Les plantes vivantes ne pouvant pas toujours être transportées directement, il est en effet important de prendre des notes sur leur apparence, leurs propriétés, leur conditions de vie, afin qu’elles puissent être correctement étudiées au retour en Europe. Les collecteurs ont recours à l’image dans le cas de spécimens périssables ou trop onéreux ou rare pour se les procurer.
Plusieurs fois au cours de ce chapitre nous avons évoqué que les spécimens rapportés en Europe sont confiés à des savants de cabinet, qui ne voyagent pas ou très peu, et se consacrent uniquement à leur étude. Cette étape, qui implique la transformation du produit naturel en objet scientifique, fera l’objet de notre prochaine partie.
Les réseaux naturalistes
Les jardins botaniques, musées et autres institutions savantes sont en constante relation par le biais d’une correspondance ininterrompue entre les savants de cabinets, les voyageurs, les employés de l’administration coloniale et autres amateurs d’histoire naturelle. Ils entretiennent des liens qui constituent une véritable République savante, née de l’idéal d’universalité des Lumières, et qui fontt fi des frontières religieuses, politiques, sociales et de langue. Ce réseau s’entend comme un « système d’échange d’informations et de collaboration entre érudits attachés à une œuvre commune » , universelle, de centralisation des connaissances en constante augmentation.
Si cette République existe vaguement dès le XVe siècle et se précise aux XVIe et XVIIe siècles, les sciences y prennent une place véritablement importante à partir du second XVII siècle, quand les sciences expérimentales se développent, et prennent la place au XVIIIe siècle de la philologie, de la métaphysique et de la théologie, jusque-là disciplines centrales. En France, l’Académie des sciences prend le pas sur l’Académie des inscriptions et belles-lettres, mais le « philosophe » devient la figure dominante des Lumières, et sa vision encyclopédique du savoir s’appuie sur les spécialistes pour se mettre en place. Cependant, l’ « Empire des sciences » (selon l’expression utilisée par les contemporains) se sépare peu à peu de la République des lettres, avant de disparaître au milieu de XIXe siècle au profit du scientifique professionnel et individuel.
En attendant et durant le second XVIIIe siècle, l’Empire des sciences est un idéal bien ancré dans la vision des naturalistes et autres savants. « Les échanges épistolaires sont un élément indispensable de la circulation des informations : écrire des lettres, en recevoir, y répondre, constituent l’une des tâches principales des érudits et des savants. »
|
Table des matières
Partie I – Les conditions de l’étude de terrain : la science en voyage
Chapitre 1 – L’organisation en amont
Les objectifs de l’exploration du Pacifique sud
La formation et les instructions de voyage
Chapitre 2 – Les difficultés du voyage au long cours
Les contraintes physiques
« Marins contre botanistes »
Chapitre 3 – La collecte et le transport des produits naturels
La récolte, la conservation et le transport des plantes vivantes
La nature dématérialisée
Partie II – Du Pacifique au Jardin : quand la nature devient objet de science
Chapitre 4 – Agir à distance
Les institutions
Les réseaux naturalistes
Chapitre 5 – Les enjeux des sciences naturelles
La pensée des Lumières
La nature utile
Chapitre 6 – L’analyse et la sauvegarde des données
La question de la classification
L’acclimatation et la conservation des spécimens
Partie III – Diffuser les images de la nature
Chapitre 7 – L’illustration du vivant
Le mariage entre la science et les arts
L’image pédagogue
Chapitre 8 – Les publications de botanique
Les parutions scientifiques
Le spectacle de la nature
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet