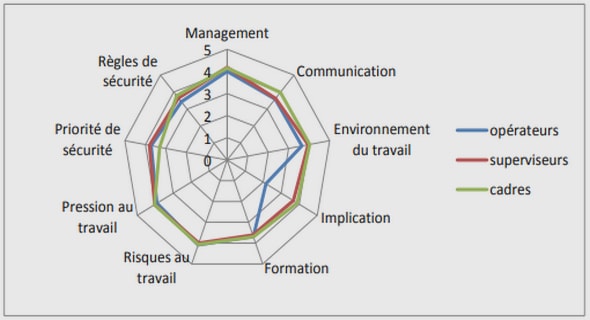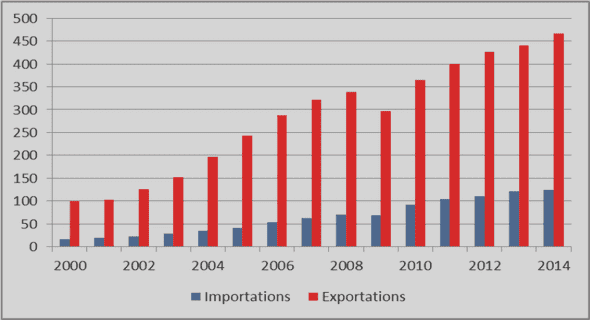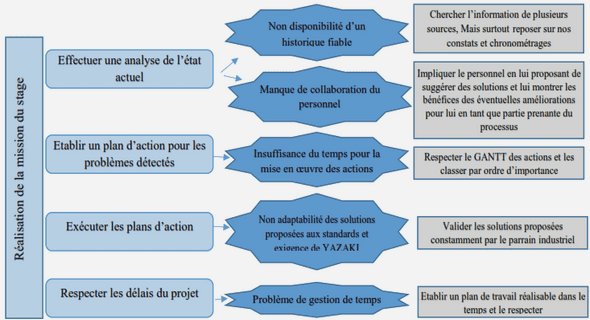Les coutumes du point de vue de l’Economie institutionnelle
Afin d’interpréter la notion d’us et coutumes, Hayek (1944) propose de recourir à une approche «institutionnaliste-individualiste» afin de comprendre l’idée d’ordre social spontané. Pour les économistes du XXè Siècle, les institutions sont des règles issues d’une communauté, permettant de comprendre les comportements des individus, particulièrement lors de leurs transactions économiques. A partir d’analyses historiques contextualisées, on définit une institution comme « un système de règles, de croyances, de normes et d’organisation qui, ensemble, génèrent une régularité de comportement ». Dit autrement, une institution se manifeste par la répétition des comportements qui, eux-mêmes, aident à reproduire l’institution. Il est alors compréhensible, par le simple fait de comportements rationnels, comment une institution s’auto renforce à travers le temps ou, au contraire, se désagrège. En considérant les institutions en tant que règles imposées « d’en-haut », North (1990) distingue deux types d’institutions : d’une part les institutions formelles qui sont l’aboutissement obstiné des individus, des « échafaudages » bâtis afin de minimiser l’incertitude ; d’autre part, les institutions informelles qui ne sont autre que le résultat des coutumes et des croyances des individus, fortement ancrées dans la culture, et très lentes à évoluer. Mais ces deux types d’institution sont complémentaires. Il est essentiel de comprendre l’idée que les institutions formelles ne peuvent fonctionner qu’à la condition que des institutions informelles compatibles soient présentes. C’est ce qui permet spécialement de saisir les raisons pour lesquelles les ambitieuses tentatives de design institutionnel du genre Programmes d’Ajustement Structurels n’ont jamais fonctionné. L’obstacle réside dans la considérable difficulté à faire coïncider règles formelles et normes informelles. De ce fait, il s’agit de bien mettre en avant cette dichotomie entre, d’un côté, les institutions formelles qui semblent pouvoir se prêter à des réformes relativement rapide et à une « sélection artificielle », et de l’autre côté, les institutions informelles, dont les coutumes, désignées autrement par « idéologie » ne pouvant évoluer que de manière incrémentale suivant un processus le plus souvent hors du contrôle des individus (North, 1990). Cette conception présente un intérêt indéniable ainsi qu’une réelle pertinence expérimentale. Toutefois, il s’annonce cruciale de se méfier car, une mal interprétation laisserait penser que les normes sociales sont la cause du sous-développement. En fait, malgré que les institutions formelles et informelles diffèrent au niveau de leur substance, elles ont la même nature, celle d’une institution : un ensemble de croyances partagées et auto-entretenues sur la manière dont chacun va agir. A partir de cette définition, on relève la question du degré de formalité d’une institution. Si un individu respecte une norme informelle, cela peut toujours s’interpréter comme un équilibre stratégique où chacun a intérêt à adopter un certain comportement compte tenu de ses anticipations sur le comportement des autres. Les institutions formelles relèvent scrupuleusement de la même logique, sauf qu’ici, il existe une troisième partie, celle qui a la responsabilité de faire appliquer la règle. Mais cela ne fait que reculer le problème d’un cran : pour quelle raison l’organisation chargée de la mise en application de la règle la fait-elle effectivement respecter ? Il s’agit encore ici d’une histoire de croyances partagées et auto-entretenues. Les agents ne respecteront la règle qu’à la condition qu’ils anticipent le fait que les agents chargés de la faire respecter le feront effectivement. Ces derniers doivent donc être d’une manière ou d’une autre incités à le faire (Elvin, 2009). C’est précisément à ce niveau que se trouve l’un des freins au développement. Une règle formelle n’a aucune valeur si personne n’est incité à la respecter ou à la faire respecter. En ce sens, il n’est pas plus facile de modifier de manière efficace des règles formelles que des normes informelles. Par ailleurs, si des règles formelles rentrent en contradiction avec des normes informelles, il est fort probable que les premières seront ineffectives pour la bonne et simple raison qu’elles ne pourront se constituer en institution, c’est à dire engendrer des comportements récurrents sur la base d’anticipations partagées. Toutefois, un autre point doit être mis en valeur: rien ne dit que l’évolution spontanée des normes informelles soit bonne dans l’absolue. Elles peuvent être probablement adaptées à l’environnement local, ce qui ne garantit pas leur perfection. C’est d’ailleurs tout le problème car, à l’instar de l’évolution biologique, l’évolution des sociétés humaines est à la fois le fait du hasard et de la nécessité (Elvin, 2009). De multiples imprévus historiques1 ont conduit au développement d’institutions adaptées au contexte2 mais au potentiel de développement très différencié. On comprend alors pourquoi le développement économique ne se prête pas au jeu de la recherche de la recette miracle. Si c’est la signification des us et coutumes proposée par l’économie institutionnelle, abordons maintenant une autre branche tout aussi intéressante qui est l’économie des conventions.
Les coutumes interprétées comme capital social
Le concept de capital social est d’une importance cruciale dans l’œuvre de Bourdieu, sociologue ayant accompli ses recherches en Kabylie se trouvant en Algérie. L’art de vivre, la civilité, la culture mondaine… de la bourgeoisie sont, pour l’auteur, des capitaux sociaux dont la fonction est de légitimer la hiérarchie sociale. Leurs pratiques habituelles paraissent s’accommoder autour de l’acquisition et de la défense du capital social, mesure symbolique de pouvoir et critère de classification qui indique à chacun sa position dans la hiérarchie sociale. L’existence du capital social libère une dynamique de compétition se manifestant publiquement sous la forme de la distinction sociale. Ce qui présuppose un ordre inégalitaire qui a besoin de croyances et de méconnaissance pour se légitimer afin de se reproduire avec le consentement des plus faibles (Bourdieu, 2004). Le capital social est un flux ayant besoin d’un vecteur, notamment d’un agent individuel actif et passif simultanément afin de pouvoir circuler et se reproduire. Actif car le capital social a besoin d’un support vivant réagissant aux variations du flux ; et passif parce que ni la nature du capital social ni le volume de son flux ne dépendent de la volonté de son propriétaire (Bourdieu, 2004). Face à cela, l’individu n’est ni un acteur souverain de son destin, ni un prisonnier de structures compliquées. C’est un agent agissant dans des conditions où les structures réagissent sur lui. Bourdieu appelle cette relation entre homme et structure « l’habitus », qui permet à l’individu d’attester sa volonté et de contribuer à la reproduction des structures qui le produisent. Bourdieu a façonné la notion de capital social à partir du sens de l’honneur afin de souligner la conflictualité qui traverse la collectivité à tous les niveaux, en partant du groupe le plus large : village ou tribu, jusqu’au dernier maillon du lignage, pour indiquer deux frères qui ne peuvent être empêchés d’être en compétition. Le capital social est ce qui divise et unit simultanément la société. II est la forme générale de toute ressource qui permet à quelqu’un d’affirmer une légitimité justifiant une inégalité. Dit autrement, le patron capitaliste donne des ordres à l’ouvrier parce qu’il possède le capital économique légitimant son autorité. L’ingénieur se fait obéir par ses subordonnés parce qu’il possède une qualification : le capital scolaire, lui permettant de diriger une équipe sur le lieu de travail. Le curé dirige la messe en raison du capital symbolique que lui prêtent ses fidèles sur la base de leurs croyances. C’est également ce qui fait que l’homme serait supérieur à sa femme parce qu’il est susceptible de posséder des capitaux sociaux et elle non. Un vieux serait supérieur à un jeune du fait du devoir de respect qu’a le second envers le premier. (Bourdieu, 2004). Il est à noter qu’il existe des typologies de capitaux sociaux. En effet, même s’ils sont tous source d’une légitimité donnant autorité, ils ne sont pas de nature identique. Les uns reposent sur un artifice juridique : la propriété privée, les autres sont obtenu à partir d’une formation ou transmission de savoir, d’autres encore découlent de croyances. Bourdieu insiste sur l’inégalité et la domination qu’ils engendrent. Il est toutefois plus critique des capitaux sociaux de la modernité que ceux de la société traditionnelle. La conviction de Bourdieu est que l’ordre traditionnel est inégalitaire statutairement mais humain socialement, à l’inverse de la modernité égalitaire formellement mais inhumaine politiquement. Selon Bourdieu, la modernité est plus inégalitaire du fait que les capitaux sociaux qu’elle génère déchirent plus la société en amplifiant la hiérarchie sociale. Le marché produit la pauvreté, le droit crée la délinquance, l’école accroît l’exclusion, etc. Afin d’éviter la pauvreté, la délinquance, l’exclusion…, l’individu se doit de posséder des capitaux sociaux de plus en plus difficiles à procurer. Il n’est pas donné à n’importe qui, en effet, d’être patron d’une entreprise industrielle, ou banquier, ou PDG d’une société, ou médecin, ou ingénieur… Ces activités étant pratiquées par les possesseurs des capitaux sociaux respectifs. En d’autres mots, ces métiers sont des statuts réservés à une élite et à ses enfants, et le plus souvent ils sont hérités de génération en génération. Il est indéniable que s’opère une distinction sur le critère de qualités psychologiques inhérentes à la personne et attribuées à l’excellence du sang du lignage. « Dans ma famille, dit le Kabyle, il n’y a pas de lâche ; il n’y a que des hommes courageux et généreux comme l’ont été mes grands-parents », cherchant ainsi à valoriser son propre lignage par rapport aux autres. La parenté, selon Bourdieu, est autant représentation que volonté, rendant la consanguinité moins rigide pour en faire une arme de compétition sociale. Le capital social, étant rattaché à la consanguinité, s’édifie sur le mythe généalogique et se déguise dans des formes symboliques pour prendre l’apparence de la réalité objective. Le lignage assure donc la transmission du capital social : le nom, hérité des générations précédentes4 . Des phrases telles que : « il est de mon sang », « nous avons le même sang et la même chair », « son grand-père est le mien », justifie donc la solidarité envers la parentèle. Bourdieu souligne que dans le village kabyle, être un héritier n’est pas satisfaisant pour faire partie de l’élite. Ce qu’il faut surtout, c’est gagner l’honneur, seul critère de hiérarchie légitime, car fait référence au mérite personnel, et être capable de le défendre soimême. Pour Bourdieu, l’homme d’honneur est courageux, il tient parole, il est digne dans son comportement et ses relations. C’est ce qui fait que Bourdieu est tout à fait convaincu que la compétition plus juste dans la société traditionnelle que dans la modernité où le renouvellement des élites s’opère par héritage qui, le plus souvent, ne se mérite pas. Pourtant la concurrence est dans la nature et aucune société ne pourrait l’abolir. Face à cela, il s’annonce opportun de naturaliser les inégalités sociales afin de leur donner le fondement légitime nécessaire pour être acceptées par tous afin de se reproduire sans coercition physique, d’où l’importance de la violence symbolique. Le village kabyle a recours à la nature pour justifier l’inégalité, en donnant la prééminence à l’être, à la personnalité de l’individu, à son ascendance. Bourdieu rappelle alors que village kabyle ne limite pas l’accumulation du capital symbolique, alors qu’il décourage, de manière subtile, celle du capital économique. Cette préférence de l’une des formes du capital illustre l’incohérence de la société traditionnelle cherchant à être plus proche de la nature alors que la société moderne cherche plutôt à s’en émanciper5. En effet, dans la première, le capital social ne se manifeste pas prioritairement dans ce que possède matériellement l’individu. II se manifeste d’abord dans ce que celui-ci est, ou ce qu’il croit être à travers les qualités psychologiques, appartenance familiale… A son opposé, dans la société moderne, la distinction a tendance à se cristalliser dans ce que possèdent les individus : capitaux financier, économique, scolaire, culturel… C’est ce qui explique pourquoi en Kabylie, l’honneur devient un capital social possédant les individus, qui croient le posséder, et imposant sa logique et ses exigences dans un monde réifié, en raison même de la rareté des biens matériels difficilement accumulables (Bourdieu, 2004). Pour légitimer l’ordre symbolique, la conscience se réfère de manière excessive à la nature. L’homme fait parler la nature à qui il prête la logique de l’ordre social qu’il construit. La légitimation des inégalités sociales par l’ordre naturel est un discours édifié pour justifier les inégalités supposées naturelles. Ce que fournit la nature ne devient capital social que parce qu’il y a compétition et lutte pour les biens rares. Ce qui est premier, c’est la compétition qui pousse les capitaux sociaux à revêtir telle ou telle forme. En Kabylie, la compétition a pour enjeu principal les biens symboliques, notamment l’honneur lié au lignage et à la consanguinité (Bourdieu, 2004). Les us et coutumes ne se limitent pas à se déguiser sous forme de convention ou de capital social, elles se manifestent également en tant que pratique.
Coutume en tant que pratique
En matière culturelle, un aspect très intéressant porte probablement sur les coutumes insolites de la population, comme c’est le cas du retournement des morts. On peut également y ajouter les rites de passage de la circoncision, du nouvel an, etc. Ces évènements mémorables de la vie marquent le parcours terrestre du malgache qui s’y conforme quelle que soit la religion ou l’idéologie à laquelle il souscrit habituellement. Il s’agit donc ici d’exposer quelques pratiques Malgaches.
a- Le « famadihana » : Les Malgaches s’identifient comme ceux qui « vivants, habitent la même maison et morts, partagent le même tombeau ». De ce fait, il n’existe guère de tombes individuelles dans leurs nécropoles: ce sont tous des caveaux ou des tombeaux communautaires, familiaux ou claniques où « les crânes sont réunis. » Plusieurs circonstances sont à la source de la pratique du « Famadihana ». Elle peut avoir lieu notamment lorsque le défunt n’a pu être enterré dans le tombeau de famille au moment du décès. Quelques années plus tard, ses proches vivants doivent alors le ramener au caveau familial. L’évènement, effectué en saison sèche, pour des raisons sanitaires, est une occasion pour faire la fête et manifester sa joie. L’autre cas est celui qui s’accompli envers chaque défunt dans la conception religieuse traditionnelle malgache, en guise d’honneur pour les ancêtres. On pense que l’aïeul a froid et a donc besoin d’un nouveau linceul. Le jour et l’heure du « Famadihana », rite funéraire qui a lieu environ tous les cinq à sept ans durant l’hiver austral, sont fixés par le « Mpanandro » ou astrologue. La cérémonie consiste à exhumer le corps puis à l’envelopper dans une natte ou « tsihy » qui sera porté par deux hommes. Tandis qu’un groupe de proches, hommes, femmes et enfants processionnent, les uns chantant, les autres jouant d’un instrument de musique. Des plaisanteries sont échangées avec les personnes rencontrées et même avec le mort. Une fois arrivé au caveau familial, le défunt est à nouveau enveloppé d’une pièce d’étoffe ou « Lambamena » neuf après avoir été l’objet d’attentions particulières. Enfin, avant qu’il ne réintègre sa demeure, la coutume veut qu’on lui fasse faire sept fois le tour du tombeau. L’ensemble de la cérémonie est exécuté dans une ambiance de fête et de réjouissance. La musique, les chants et les rythmes se mêlent au sacrifice d’un zébu et au partage de sa viande. Un discours en mémoire du mort et à la destinée des vivants closent la cérémonie. Cette coutume se trouve de nos jours remise en question voire rejetée par certains, à cause de l’influence des occidentaux, de la religion et bien d’autres raisons encore. Pourtant l’aspect économique que cette coutume reflète est souvent ignoré. En effet, selon Randriamihanta de la Trano Koltoraly Malagasy, le « famadihana » constitue un fond de démarrage pour ceux qui comprennent bien son esprit. Un bénéfice d’environ quatre à cinq million d’ariary, pouvant même aller jusqu’à dix million d’ariary dans certaine région, est dégagé par l’intermédiaire de ce qu’on entend par « atero-kalao » ou contre-don. Cela signifie que si vous avez invité quelqu’un qui a donné une offrande de dix mille ariary, lorsqu’il vous invite à son tour, vous devrez lui offrir plus que cette somme en guise de reconnaissance et tous les invités avec la somme de leurs offrandes sont enregistrés dans un cahier. La somme totale que les organisateurs vont percevoir va donc dépasser de loin leur dépense en viande et riz pouvant provenir même de leur excédent de culture et d’élevage. En outre, cette pratique émet diverses externalités. Puisqu’elle peut durer quelques jours, c’est une occasion pour les commerçants de venir profiter afin d’écouler leurs produits. Elle permet également aux transporteurs d’augmenter les frais pour combler les périodes de l’année durant lesquelles il n’y a que peu de voyageurs. C’est également un pic de référence pour toute la famille qui va être réunie. En effet, tous ceux qui sont partis loin à cause de leur travail vont rejoindre leur terre d’origine appelée « Tanindrazana » ou encore « faisana ». C’est là donc que s’opèrera une comparaison des niveaux de vie, ce qui va constituer une motivation pour devenir plus productif. Ce grand évènement constitue un véritable investissement social.
b- Les « fomba » et « fady » : Le comportement du Malgache est régi par maints usages ou fomba et interdits ou fady propres à une famille, un clan, une région, … La fonction des « fomba » et des « fady » est de maintenir le sentiment d’appartenance à un groupe et de faire le lien avec le monde sacré. Ainsi lorsqu’un lieu, par exemple, est fady, il faut respecter certaines règles : ne rien jeter, ne rien ramasser, ne pas se baigner…. Ces règles sont propres à chaque lieu et sont légitimées souvent par une histoire ancestrale. La traduction que l’on attribue à « Fady» est tabou. L’autorité de « Razana » ou ancêtre divinisé est alors imposée à travers des ordres qui s’accompagnent de « fady ». Désobéir à un fady signifie se rendre coupable envers les ancêtres. Ainsi, une complexité et une diversité importantes d’interdits se créent en fonction de chaque personne selon son sexe, son appartenance familiale ou communautaire, mais également selon l’espace et le temps. Une personne peut entre autre être soumise à un fady communautaire13, un fady temporel14, ainsi qu’à un fady géographique15. L’usage peut au fil du temps dériver sur une tradition ou « Fomba ». S’opposer à la coutume entraînerait un châtiment de la part des ancêtres. Des jours peuvent être fady, notamment pour les enterrements ou la construction d’une maison. L’interdit peut concerner également l’alimentation comme le cochon, l’oignon, le chèvre,….il se transmet par le père ou la mère de génération en génération. Si l’interdit est enfreint, l’auteur commet une faute vis à vis des ancêtres et s’expose à des risques pouvant aller jusqu’à perdre sa vie. On raconte qu’un chinois, ignorant deux fady: ne pas transporter de porc et ne pas se baigner s’est noyé dans le lac Titriva. Pour les visiteurs, les lieux fady se reconnaissent quelque fois par un tissu blanc accroché à un arbre ou un autre repère distinctif, aussi les habitants sont là pour veiller et informer les nouveaux venus. Pour plus de précision, il existe un gardien du fady, responsable de son interprétation et de son application, souvent le chef du village ou un ancien. Derrière ces rites, on peut admettre une sagesse des ancêtres Malgaches. En effet, si le terme développement durable ne s’est développé qu’actuellement, vu la dégradation de l’environnement, nos aïeuls ont déjà eu cette idée à leur époque. En effet, s’il n’y avait pas ces coutumes, on n’aurait pas pu conserver aujourd’hui les biodiversités de Madagascar. Les générations les plus lointaines pourront jouir des particularités de l’île, car les gens n’osent pas pratiquer des exploitations par respect des ancêtres.
c- Le Nouvel An malgache ou « taom-baovao malagasy » : Randriamihanta, coordonateur de la « Trano koltoraly malagasy » affirme que cette coutume est célébrée tous les ans au mois de mars. Elle se base sur la tradition malgache et non sur des croyances. Tous les habitants de la Grande île peuvent donc la suivre. Cette fête particulière met en valeur le « fihavanana » et se base sur trois principes fondamentaux : les purifications ou « fidiovana », le « Tsodrano » ou « fafirano » et le « Santatra ».
Les purifications : S’agissant du premier principe, il est également appelé « hasim-pidiovana ». On distingue les purifications corporelles, sociales et spirituelles. La purification corporelle se réfère à une alimentation non carnée un mois avant le Nouvel An malgache. Toutefois, la consommation de volailles est permise pour ceux qui ne supportent pas ce régime. Un jour avant le Nouvel An, un grand nettoyage est réalisé, touchant tout l’environnement de l’individu, que ce soit sa maison ou son lieu de travail. Tout le monde procède à des ablutions corporelles à l’image du « mpanjaka » qui procédait à la cérémonie du « fandroana ». La purification sociale consiste à effacer toutes les querelles au niveau social et familial. C’est avec un esprit de concorde et d’unité que la communauté aborde cette célébration du Nouvel An malgache. Quant à la purification spirituelle, tout le monde doit faire preuve de remords et laisser derrière lui toutes les mauvaises pensées de l’année écoulée.
Le « Tsodrano » : Le jour de la célébration, tout le monde se souhaite une bonne et heureuse année. Chacun reçoit alors la bénédiction ou « tsodrano » pour que ce vœu se réalise.
Le « Santatra » : La nouvelle année doit commencer par la prise d’un repas très nourrissant : le riz au lait arrosé de miel. Ces éléments ont une signification particulière. Le riz est la base de la nourriture du Malgache. Le lait est le symbole de la vie, tandis que le miel va permettre à tous les souhaits d’être réalisés. La détermination de la date de célébration du Nouvel An malgache est invariable, car elle suit un calendrier astrologique précis. Cet évènement est toujours fixé au mois de mars. Il peut se dérouler tout au long de ce mois, dans n’importe quel endroit et peut se faire même au sein de chaque famille malgache.
d- Le kabary : Les discours traditionnels que constituent les Kabary tiennent une place particulière dans la vie sociale malgache. Aucun événement important16 ne peut débuter sans être précédé d’un ou de plusieurs kabary, véritables joutes oratoires entre différents intervenants. Les plus importants sont ceux prononcés par les monarques et ceux des demandes en mariage qui peuvent durer des heures. Les kabary sont nés avant l’arrivée de l’écriture à Madagascar, d’où l’importance du « lovantsofina » ou tradition orale dans sa transmission. Le kabary sert à expliquer, persuader et condenser des idées. Pour permettre leur mémorisation, le « mpikabary » ou orateur fait appel à des expressions ou citations qui ne se confondent pas avec le langage commun mais restent toutefois assez accessibles. La qualité d’un discours se juge par la pertinence et la quantité des expressions choisies par l’orateur et c’est généralement au cours du rituel de purification, le fialan-tsiny, qu’il doit faire preuve de son habileté. Il doit se montrer à la fois enjoué, ironique et plein d’humour afin d’emporter l’adhésion de son auditoire. Ces expressions verbales sont généralement les proverbes, les adages, les dictons. Le Malgache ne faisant pas la distinction, toutes ces expressions entrent dans la catégorie desohabolana ou proverbes. Quelques orateurs expérimentés font parfois appel aux hain-teny17 dans les kabary de demande en mariage. Si la pratique du kabary était jusqu’ici réservée aux hommes, de plus en plus de femmes et de jeunes se passionnent aujourd’hui pour cet art de l’éloquence par excellence.
e- La circoncision : La circoncision est un rituel qui permet à l’enfant de passer du monde des femmes au monde des hommes. Cette tradition veut que tout enfant mâle soit circoncis afin d’acquérir la virilité. L’enfant circoncis entre alors dans le monde des adultes et est adopté par la tribu. Cela est reflété lorsqu’à l’issue du rituel, le petit garçon reçoit la bénédiction des parents et est intégré dans le « Tranobe » ou maison sacrée. La circoncision consiste à effectuer une opération pour prélever le prépuce. Cette cérémonie se fait de plus en plus avec l’aide d’un médecin, mais traditionnellement on envoyait les guerriers chercher l’eau sacrée qui servait à un « chirurgien » pour nettoyer la plaie. Elle peut être individuelle ou collective. Le « Sambatra » ou circoncision groupée est une cérémonie rituelle célébrée en hiver, de juillet à septembre selon la tradition, mais aussi pour des raisons d’hygiène. Il demeure une fête importante dans les régions rurales, en particulier dans le Sud-Est, où il est célébré durant un mois tous les sept ans. Tous les enfants non circoncis, pendant les sept dernières années, sont réunis et amenés auprès du « Rain-jaza » ou guérisseur traditionnel, le premier Vendredi de la pleine lune. Aidés par la famille et les amis, les parents commencent à construire le » lapa « , une hutte aménagée pour la circonstance. Plusieurs jours durant, des chansons traditionnelles sont chantées et la population se livre à des danses frénétiques accompagnées d’instruments tels que l’accordéon, le « valiha » et les tambours. Des jeux et des compétitions sportives sont organisés. Le jour » J « , tôt le matin, au premier chant du coq, les jeunes gens « velondray aman-dreny », c’est-à-dire non orphelins de père et de mère vont aller chercher le « rano mahery » ou eau sacrée à la source sacrée. Au retour, des attaques sont simulées comme pour les empêcher de ramener l’eau sacrée dans le lapa. Si par malheur, le récipient tombe, ils seront ainsi obligés de retourner à la source. Ils doivent alors faire preuve de ruse pour pouvoir accomplir leur mission. L’eau sacrée est accueillie au lapa par les familles qui clament en chœur « Zanaboromahery , manatody vato ». Alors le Rain-jaza commence son travail de circoncision en suivant scrupuleusement un rituel. Les chants et les cris des femmes masquent les pleurs et les gémissements des enfants circoncis. La circoncision terminée, les pères ou les grands-pères avalent les prépuces de leurs enfants circoncis enveloppés dans une banane ou un blanc d’œuf. La cérémonie se termine toujours par un grand festin accompagné de boissons fortes. La liste des coutumes malgaches n’est pas close, c’est pourquoi nous allons parler d’un autre aspect qui est le patrimoine
|
Table des matières
REMERCIEMENT
LISTE DES TABLEAUX
INTRODUCTION
CHAPITRE I : US ET COUTUME : QUELLE LECTURE ?
Section 1- Lecture multidisciplinaire
Section 2- Lecture économique
1- Les coutumes du point de vue de l’Economie institutionnelle
2- Les coutumes du point de vue de l’Economie conventionnelle
3- Les coutumes interprétées comme capital social
4- Les coutumes sous forme de pratique
CHAPITRE II : US ET COUTUME : QUELLE RELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT ?
Section 1- Liens négatifs entre coutume et développement
Section 2- Liens positifs entre coutume et développement
CHAPITRE III : US ET COUTUME MALAGASY: PORTEUR OU FREIN AU DEVELOPPEMENT ?
Section 1- Typologie de quelques us et coutumes Malgaches
1- Coutume en tant que convention et capital social
2- Coutume en tant que pratique
3- Coutume en tant que patrimoine
Section 2- Les us et coutumes malgaches : quels apports pour le développement ?
1- Aspect des coutumes potentiellement défavorables au développement
2- Aspect des coutumes potentiellement favorables au développement
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet