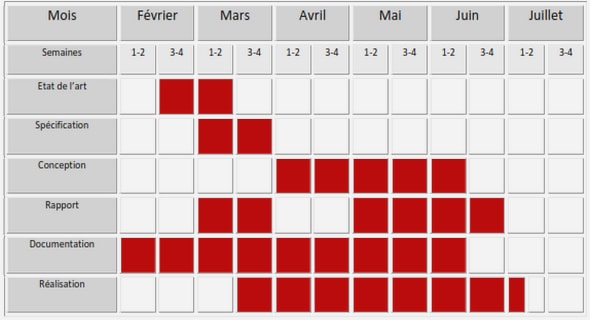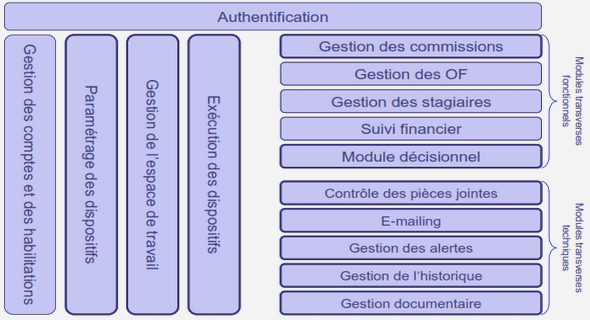Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les suivis de la biodiversité
G é n é ral ité s
Au vu de ce qui a été dit au chapitre précédent, il apparaît primordial de disposer d’outils permettant de mesurer et de suivre l’état de la biodiversité (Stork, Samways, & Eeley, 1996). C’est le rôle des programmes que nous désignerons sous les termes de monitorings ou de suivis dans la suite de ce document (Encadré 3). L’idée de suivre la biodiversité n’est pas nouvelle. Ainsi, le suivi des oiseaux nicheurs nord-américains date des années 1960 (Peterjohn, Sauer, & Link, 1996). Toutefois, ce n’est que récemment qu’a été soulignée la nécessité de disposer de monitorings de la biodiversité à grande échelle, sur une large variété de groupes taxonomiques (Pereira & Cooper, 2006). Cette prise de conscience fait suite, notamment, aux engagements des 190 pays ayant ratifié la convention sur la diversité biologique (UNEP, 1992) de freiner l’érosion de leur biodiversité de manière significative d’ici 2010 (UNEP, 2002a). Des monitorings environnementaux à large échelle constituent alors les seuls instruments capables de mesurer les progrès réels accomplis vers cet objectif ambitieux (Balmford, Green, & Jenkins, 2003).
Les programmes de suivis des communautés végétales à large échelle sont encore rares, aussi les évolutions temporelles habituellement inférées pour ces communautés sont-elles souvent établies à partir des seules données disponibles à l’heure actuelle, constitués par l’ensemble des données naturalistes. Ces données comprennent essentiellement des données historiques (herbier) et des données d’inventaires (carte de répartition et atlas).
Utilité des données historiques
Les parts d’herbiers anciens, lorsqu’elles sont accompagnées des renseignements suffisants, peuvent témoigner de disparitions locales de populations, ou même de disparitions d’espèces à l’échelle d’une région. C’est ainsi que des cas de disparition d’espèces ont pu être documentées dans la région parisienne, suite à la destruction de leur habitat par l’urbanisation ou l’agriculture, tels que Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex Koch présent dans le Val d’Oise au XIXième siècle (Lebrun, 1962), ou Dactylorhiza sambucina (L.) Soó présente en Seine-et-Marne jusqu’au milieu du XXième siècle (Virot, 1950).
Utilité et limites des données d’inventaires2
Les données d’inventaires, quant à elles, sont souvent les seules données disponibles à l’heure actuelle pour évaluer les changements de diversité végétale d’une région. Ce type de données fournit de précieux renseignements sur la chorologie des espèces, la richesse d’une région, et sur l’évolution de ces paramètres. C’est ainsi que la publication périodique d’atlas de répartition au Royaume-Uni (BSBI Monitoring Scheme) a d’ores et déjà permis d’observer des changements dans la flore à l’échelle du demi-siècle ; ainsi, les plantes typiques des prairies, des milieux agricoles, et des habitats aquatiques, tendent à voir leur aire de répartition se réduire, tandis que dans le même temps, des plantes introduites sont en pleine expansion (Rich & Woodruff, 1996). Par ailleurs, un déclin des plantes d’affinité nordique et une expansion d’espèces méditerranéennes ont pu êtres détectés (Preston, Pearman, & Dines, 2002b). Ce type de phénomène a également pu être montré par des inventaires menés dans d’autres régions. Une expansion récente d’espèces méditerranéennes a ainsi été mise en évidence dans le Bassin parisien, avec des espèces telles que Andryala integrifolia L., Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Sporobolus indicus (L.) R.Br. ou encore Scolymus hispanicus L.
Les inventaires apparaissent donc comme des éléments de base dans le cadre de tout suivi de la biodiversité. Toutefois, ils présentent aussi un certain nombre de limites dans leur intérêt. En premier lieu, il est souvent reproché un manque de standardisation aux méthodes d’inventaires. Ainsi, estimer un changement de fréquence des espèces au cours du temps, comme cela a été fait au Royaume-Uni, implique des prises de données homogènes d’un inventaire à l’autre, ce qui est rarement le cas et entraîne de nombreux biais et sources de variabilités (Hortal, Lobo, & Jimenez-Valverde, 2007). On peut citer notamment :
(1) Une pression d’échantillonnage inégale sur le territoire d’étude (Hortal, Jimenez-Valverde, Gomez, Lobo, & Baselga, in press; Rich, 1998; Rich & Smith, 1996), ou au cours du temps (Rich, 2006). Ainsi, les zones les plus proches des villes, ou des centres universitaires, sont généralement répertoriées comme les plus riches au niveau floristique. Un tel patron est souvent purement artificiel et s’explique par une prospection plus intense par les botanistes, plus nombreux dans ces secteurs (Moerman & Estabrook, 2006).
L’intérêt des suivis quantitatifs des espèces communes
Une limite à l’utilisation des inventaires en tant qu’outils exclusifs de suivis, est l’absence d’informations sur l’abondance des espèces à l’échelle d’un territoire. Les inventaires sont avant tout conçus pour obtenir des informations qualitatives sur la biodiversité d’une région. Ainsi, même lorsqu’ils répondent à des critères de standardisation élevés, ils ne peuvent fournir des informations que sur la présence d’une espèce dans un secteur donné (même si l’abondance locale est renseignée), le grain de l’information obtenue étant variable selon la taille de la région d’étude. Ainsi, des atlas nationaux auront tendance à employer un maillage de taille importante (100 km2 pour l’atlas du Royaume-Uni (Preston et al., 2002b)) tandis que des atlas régionaux ou départementaux pourront se permettre un grain plus fin ; 25 km2 pour l’atlas de la région Auvergne (Antonetti, Brugel, Kessler, Barbe, & Tort, 2006), ou encore 1 km2 pour celui des Hauts-de-Seine (Muratet, 2006). Dans tous ces cas, des changements affectant une espèce, comme une baisse de ses effectifs en réponse à une modification de l’environnement, ne pourront être détectés qu’une fois que l’espèce aura commencé à disparaître de plusieurs unités d’échantillonnage. Or, avant d’en arriver à ce stade, une espèce passe nécessairement par une phase où ses populations subissent des extinctions locales. Cette phase, qui peut être longue, passera inaperçue avec des inventaires qui continueront à répertorier des populations de cette espèce dans leurs unités d’échantillonnage (Leon-Cortes et al., 1999; Preston, 2003).
Ainsi a émergé l’idée de coupler les inventaires à des observatoires quantitatifs de la biodiversité, afin de détecter les fluctuations d’abondance de certaines espèces. De tels observatoires ont d’ores et déjà été mis en place dans certains pays (Encadré 4), ils fonctionnent sur le principe suivant : Des placettes d’observation permanentes de surface relativement faible sont tirées au sort à travers le territoire d’étude. L’ensemble des espèces se trouvant dans ces placettes est alors relevé périodiquement. Le fait d’utiliser de nombreux petits relevés dispersés, par rapport à une plus grande surface d’inventaire d’un seul bloc, présente plusieurs avantages :
(1) Cela permet d’évaluer simplement l’abondance d’une espèce dans une région, en comptabilisant le nombre de placettes dans lesquelles elle est présente.
Encadré 4 (suite)
des placettes permanentes dont la taille (de 4 m2 à 200 m2) et la localisation sont fonction des différents types de milieux se trouvant dans la maille. Grâce aux campagnes de terrain régulièrement effectuées depuis 20 ans (la dernière en 2007), des changements ont déjà pu être observés. Il a ainsi été montré une raréfaction des plantes stress-tolérantes et une extension des plantes généralistes, suite à une eutrophisation généralisée des milieux (Smart et al., 2005).
Le Monitoring de la biodiversité Suisse (MBD) (Weber, Hintermann, & Zangger, 2004) est un programme de suivi lancé en 1995 par l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. Une partie de ce dispositif s’est fixé comme objectif l’obtention d’indicateurs d’état sur les espèces de plantes communes. La stratégie d’échantillonnage correspond à un dispositif systématique qui peut se décomposer en deux réseaux emboîtés. (1) Un premier réseau est constitué d’un ensemble de 1600 placettes fixes de 10 m2 réparties régulièrement sur l’ensemble du territoire (Figure 4a) dans lesquelles l’ensemble des plantes sont relevées. Afin de prendre en compte les plantes répandues sans être forcément abondantes (par exemple les plantes vivant dans des écotones) un deuxième dispositif consiste en un ensemble de 520 mailles d’1 km2 disposées selon un maillage plus lâche que précédemment (Figure 4b). Un transect de 2,5 km est alors réalisé dans chaque maille le long duquel toutes les plantes vasculaires sont notées. La première phase de collecte du terrain du MBD s’étant achevée en 2005 il n’a pas encore généré de résultats.
(2) Ce type de dispositif est plus à même de détecter des extinctions locales d’espèces qui passeraient inaperçues à plus large échelle. De plus, on peut raisonnablement postuler qu’une espèce qui n’est plus retrouvée sur une petite surface où elle avait été observée auparavant a réellement disparu de cette surface. Être sûr qu’une espèce a disparu d’une zone de grande taille (de l’ordre d’un hectare ou plus) est beaucoup plus difficile (Walker, 2003).
(3) Enfin, le fait de mener des inventaires sur de petites surfaces est souvent considéré comme un moyen de limiter certains biais, en assurant une homogénéité de la pression d’échantillonnage sur l’ensemble de la surface à inventorier. Ainsi les petits relevés sont souvent considérés comme un moyen de prospecter plus efficacement la zone d’inventaire et de manquer moins d’espèces que dans un plus grand relevé (Hintermann et al., 2002). Une étude récente remet toutefois en cause cet argument (Archaux, Bergès, & Chevalier, 2007).
Afin de disposer d’informations fiables sur les fluctuations d’effectifs d’une espèce donnée, il est nécessaire que cette espèce se trouve dans un nombre important de relevés. C’est pourquoi les suivis quantitatifs de la biodiversité n’ont vocation qu’à suivre l’abondance des espèces les plus communes du territoire étudié. Bien que limitée en nombre d’espèces, cette fraction d’espèces communes joue un rôle essentiel dans les écosystèmes, comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre précédent. Dans le cadre de monitorings de la biodiversité, les suivis quantitatifs d’espèces communessont donc des outils essentiels, complétant utilement les inventaires floristiques et les suivis d’espèces emblématiques, qui permettent eux d’obtenir des informations sur les espèces plus rares.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons décrire les deux observatoires quantitatifs de la flore que nous avons mis en place. Dans les deux cas, les protocoles retenus ont été choisis afin de satisfaire à des critères de standardisation scientifique, tout en restant simples à mettre en œuvre. La mise en pratique de ces protocoles a été faite dans la région Île-de-France, qui fait l’objet d’une description dans la section suivante.
Présentation du territoire d’étude
L’ensemble de la collecte des données a été effectué dans la région Île-de-France. Nous allons évoquer quelques caractéristiques de ce territoire afin de comprendre certaines de ses particularités et son intérêt en tant que région d’étude.
G é og ra ph ie
La région Île-de-France est constituée de huit départements, comprenant Paris, et de 1281 communes, pour une surface totale de 12072 Km2. Par sa position géographique, l’Île-de-France se situe à la croisée des différentes influences climatiques présentes dans le bassin Parisien. L’ouest de la région (Vexin et Rambouillet) est plutôt sous l’influence directe du climat atlantique tandis que le sud (Fontainebleau et sud Essonne) est soumis à des conditions plus méridionales, enfin l’extrême est (Bassé) se trouve exposé à des conditions davantage continentales (Nascimento & Acerbi, 2003). Malgré ces variantes régionales, le climat de la région peut être qualifié de tempéré océanique avec des précipitations annuelles de 570 mm en moyenne, et des températures moyennes de 12°C. Les plus hautes températures sont habituellement atteintes en juillet, avec une moyenne de 20,5°C, tandis que les températures les plus basses sont généralement enregistrées au mois de janvier, avec une moyenne de 2,5°C (données mesurées sur la période de 2004 à 2006 par Météo France).
Le territoire a été marqué par une importante érosion fluviale, de sorte que l’on peut distinguer un relief comportant plateaux, terrasses alluviales et vallées (Figure 5). Le tout reste toutefois relativement modeste avec une altitude variant entre 11 m et 217 m.
Répartition humaine et occupation du sol
Bien que de faible surface par rapport aux autres régions françaises, l’Île-de-France est de loin la plus peuplée avec près de 11 millions d’habitants, soit 19% de la population française. La densité moyenne y est dix fois supérieure à la moyenne nationale avec 922 habitants/km2. La population se répartit essentiellement dans la petite couronne et l’agglomération parisienne où la densité atteint 20437 habitants/km2. Cette répartition de la population permet de comprendre l’occupation du sol (Figure 7) qui se structure suivant des couronnes concentriques autour de Paris.
En partant du centre, on trouve une forte concentration d’habitats collectifs. Aux alentours, dans la petite couronne, apparaît un tissu d’habitats individuels dense. Au-delà, entre 10 et 30 km de Paris se trouve une « ceinture verte » composée d’un mélange d’espaces ruraux et d’habitats comprenant notamment la plupart des villes nouvelles. Enfin, ces différentes couronnes sont entourées par une large zone rurale (Nascimento & Acerbi, 2003). L’ensemble est innervé par une infrastructure routière et ferroviaire dont le développement s’est fait de façon concentrique autour de la capitale, et radiale selon les grands axes d’extension de l’agglomération. Il en résulte un réseau routier deux fois plus dense (3,1 km/km2) que la moyenne du territoire (1,6 km/km2). Ce réseau a pour conséquence directe un haut degré de fragmentation du territoire francilien (Figure 6). Ainsi, la taille moyenne des surfaces forestières d’un seul tenant est à peine de 12 ha. De même, seuls deux espaces agro-forestiers dépassent les 5000 ha d’un seul tenant.
Lorsque l’on s’intéresse aux différentes catégories d’occupation du sol (Figure 7), l’espace rural occupe plus de la moitié de la région (54,8%), tandis que les forêts en couvrent un peu moins d’un quart (23%). L’ensemble des milieux naturels non boisés (zones humides, prairies, etc.) n’occupe qu’une portion congrue du territoire (moins de 2%). Les zones artificielles (habitations, chantiers, transports, etc.), quant à elles, couvrent 20,7% de la région.
L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol au cours des 20 dernières années (Figure 8) nous montre que ces zones artificielles sont en constante augmentation et gagnent du terrain sur l’espace rural. Ce phénomène s’explique par l’urbanisation galopante à l’origine du mitage des zones agricoles : 334 km2 de terrains agricoles ont ainsi été perdus au cours des 20 dernières années au profit de l’urbanisation ; une surface équivalente à Paris et la Seine-Saint-Denis réunis.
Intérêt en tant que modèle d’étude
Au vu des caractéristiques décrites précédemment, le territoire francilien apparaît donc comme un bon modèle de région fortement anthropisée. Deux types de pressions anthropiques apparaissent prépondérantes dans cette région :
(1) Les pressions directes engendrées par l’occupation humaine : elles se traduisent par une artificialisation et une fragmentation du milieu, corrélées au gradient de densité humaine.
(2) L’impact de l’agriculture : Les espaces ruraux, qui occupent la moitié du territoire, sont constitués essentiellement de cultures intensives, avec des régions extrêmement productives telles la Beauce et la Brie qui possèdent les plus forts rendements européens, notamment pour la production de blé.
Les protocoles d’échantillonnage décrits dans la partie suivante ont servi à quantifier l’impact de ces deux pressions humaines sur les communautés de plantes communes.
Controverses autour de la parataxonomie
Une concurrente de la taxonomie ?
En premier lieu, certains auteurs font valoir qu’il est plus simple de former de vrais taxonomistes car, bien que les méthodes parataxonomiques soient censées être plus légères à mettre en œuvre, l’investissement en temps et en argent pour former des parataxonomistes efficaces est loin d’être négligeable (Brower, 1995). De manière plus générale, il est souvent reproché à ces méthodes d’essayer de fournir une solution de substitution définitive à la taxonomie, à l’heure où cette discipline est peu à peu délaissée (Brower, 1995; Goldstein, 1997), ce dont se défendent les partisans de la parataxonomie (Beattie & Oliver, 1995; Beattie & Oliver, 1999). Ces derniers sont bien conscients que la parataxonomie doit être vue comme une solutions temporaire, permettant de continuer à disposer de données pour des études d’écologie (Oliver et al., 2000), en période de pénurie de taxonomistes.
Des informations limitées et biaisées ?
Il est également reproché à la parataxonomie de ne donner accès qu’à la richesse spécifique d’un milieu, ce critère n’étant pas forcément le meilleur pour décider de son intérêt (Goldstein, 1997; Goldstein, 1999).
Même pour ce qui est de recenser un nombre d’espèces, ce type d’approches comporterait des biais intrinsèques pouvant rendre difficile leur évaluation exacte. En effet, l’utilisation de critères morphologiques induit des erreurs, en raison du polymorphisme de certaines espèces, tel le dimorphisme sexuel (Derraik et al., 2002), ou la présence de stades juvéniles de formes très différentes du stade adulte (Beattie & Oliver, 1995). Cependant, la distribution de la variation morphologique n’est pas homogène entre les différentes familles. Dans certaines familles, des critères morphologiques peuvent être jugés pertinents pour
L’émergence de l’écologie citoyenne (Trumbull et al., 2000), impliquant des observateurs non spécialistes dans des programmes scientifiques (Engel & Voshell, 2002; Penrose & Call, 1995; Stewart et al., 2006), pourrait être un moyen de faciliter l’instauration des programmes de suivis de la nature ordinaire à large échelle.
De manière générale, l’implication de volontaires dans des programmes écologiques peut avoir plusieurs objectifs, telle que la récolte de spécimens biologiques (Janzen, 2004) ou de données de suivis portant sur des paramètres environnementaux (Holck, in press), ou sur la présence d’espèces particulières sur un lieu donné (Pilgrim & Hutchinson, 2003) de manière répétée dans le temps.
En dépit du scepticisme de certains scientifiques, qui doutent de la qualité de telles données (Firehock & West, 1995; Foster-Smith & Evans, 2003), le recours au volontariat est couramment utilisé. Il peut avoir plusieurs finalités:
En tant qu’outil éducatif afin de permettre au grand public, en particulier les jeunes (Feinsingera, Marguttib, & Oviedoc, 1997) de prendre conscience de la nature qui les entoure. C’est le cas notamment lors des « BioBlitz » qui consistent à inventorier en un temps limité le maximum d’espèces d’un parc urbain, et sont l’occasion d’impliquer des observateurs volontaires aux côtés de scientifiques (Lundmark, 2003).
Outre l’aspect pédagogique, la participation de volontaires à des études de biodiversité peut avoir comme but premier la récolte de données utilisables dans le cadre de suivis, et répondant à des critères de qualité en terme de standardisation (Evans et al., 2005). Cela peut être fait suivant deux démarches distinctes :
(1) Une première approche va s’appuyer sur des amateurs ayant des connaissances naturalistes très pointues sur le groupe étudié. C’est le cas de nombreux suivis ornithologiques tel que le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) en France (Julliard & Jiguet, 2002).
(2) D’autres approches vont utiliser des volontaires n’ayant que peu voire pas de connaissances naturalistes. C’est le cas pas exemple du « common plant survey » au Royaume-Uni (Stewart et al., 2006) basé sur la reconnaissance d’un nombre restreint d’espèces facilement identifiables. En France, une approche similaire est adoptée par l’observatoire des papillons de jardins. Lorsque les volontaires impliqués dans les suivis n’ont pas de connaissance naturaliste particulière, la parataxonomie peut constituer une alternative possible (Fore et al., 2001). Il est ainsi question d’avoir recours à ce type d’approches pour permettre à des agriculteurs de suivre la biodiversité de leurs exploitations (Boller et al., 2004; Orth, Balay, & Loiseau, in prep).
Il en résulte qu’en utilisant ces méthodes, malgré des risques importants d’erreurs, l’erreur nette, basée sur la différence entre le nombre de morphotypes trouvés et le nombre d’espèces « réelles », paraît souvent très faible car les surestimations compensent souvent les sous-estimations au sein d’un même groupe (Krell, 2004). Dans une revue sur ce sujet, Krell (2004) reproche ainsi aux publications utilisant ces méthodes de ne montrer que ce pourcentage d’erreur nette, ce qui donne une image embellie de la réalité. Un critère plus objectif pour évaluer ces méthodes correspondrait à un pourcentage d’exactitude mesurant la correspondance entre les morphotypes trouvés par les parataxonomistes avec les espèces identifiées par un expert dans le même échantillon, or une telle statistique est rarement utilisée dans les études sur la parataxonomie.
Une méthode non scientifique?
Enfin une dernière objection formulée porte sur la rigueur des méthodes parataxonomiques. Ainsi selon Krell (2004), le classement en morphotypes comprend une part de subjectivité d’un observateur à l’autre, bien supérieure à celle que l’on trouvera entre différents taxonomistes procédant à une détermination en utilisant une clé d’identification. L’auteur considère donc que la parataxonomie ne peut être considérée comme une méthode scientifique, en raison notamment de ce manque de reproductibilité.
Objectifs de notre étude
En dépit de ces critiques, peu d’études ont toutefois tenté de quantifier les différents biais évoqués. A l’heure actuelle, seules quelques publications — portant essentiellement sur différents groupes d’arthropodes — ont procédé à des comparaisons entre taxonomie et parataxonomie, afin de tester l’efficacité de ces méthodes pour évaluer la richesse locale d’un milieu (Cranston & Hillman, 1992; Oliver & Beattie, 1996a; Oliver & Beattie, 1993; Oliver & Beattie, 1996b), ainsi que les différences de composition d’espèces entre milieux (Derraik et al., 2002). Enfin, à notre connaissance, aucune étude n’a testé si la parataxonomie répondait à des critères permettant de la définir comme une méthode scientifique.
Dans ce contexte nous avons tenté d’évaluer l’intérêt et la fiabilité de la parataxonomie dans le cas où elle serait employée comme méthode de suivi des communautés de plantes communes — de telles approches ayant déjà été mise en place en milieu agricole (Boller et al., 2004; Orth et al., in prep). Nous nous sommes fixé comme objectif de répondre aux questions suivantes:
(1) Peut-on utiliser des morphotypes pour évaluer la richesse d’un milieu (diversité alpha), et les changements affectant la composition en espèces de ce milieu au cours du temps (diversité beta) ?
(2) Ce type d’approche peut-elle être considérée comme scientifique? Nous avons traité cette question en considérant la reproductibilité (variation entre observateurs) et la répétabilité (variation chez un même observateur) comme les critères de bases d’une méthode scientifique (Cassey & Blackburn, 2006).
Ces questions font l’objet de la publication qui suit dans laquelle nous avons comparé :
(1) Les résultats obtenus avec des relevés botaniques classiques et des relevés utilisant des morphotypes.
(2) Les différences de classement en morphotypes entre différents observateurs.
|
Table des matières
I. INTRODUCTION GENERALE: CRISE DE LA BIODIVERSITE, PLACE ET INTERET DE LA NATURE ORDINAIRE EN BIOLOGIE DE LA CONSERVATION
A. IMPACT HUMAIN SUR LA BIOSPHERE ET CRISE DE LA BIODIVERSITE
B. L’EMERGENCE DE LA BIOLOGIE DE LA CONSERVATION
C. LES LIMITES DE LA SANCTUARISATION DE LA NATURE
D. L’IMPORTANCE DE LA NATURE ORDINAIRE
E. L’UTILISATION DES ESPECES RARES ET LEURS LIMITES EN TANT QU’INDICATRICES
F. L’INTERET DE L’UTILISATION DES ESPECES COMMUNES DANS LE CADRE DE SUIVIS
G. QUELLE PLACE POUR LA FLORE COMMUNE DANS LES SUIVIS DE BIODIVERSITE ?
H. OBJECTIFS DE LA THESE
II. MATERIEL ET METHODES: COMMENT SUIVRE LES COMMUNAUTES DE PLANTES COMMUNES ? TERRITOIRE D’ETUDE ET PROTOCOLES UTILISES
A. LES SUIVIS DE LA BIODIVERSITE
1. Généralités
a) Utilité des données historiques
b) Utilité et limites des données d’inventaires
2. L’intérêt des suivis quantitatifs des espèces communes
B. PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE
1. Géographie
2. Répartition humaine et occupation du sol
3. Intérêt en tant que modèle d’étude
C. SUIVI DE LA FLORE A LARGE ECHELLE
D. SUIVI DE LA FLORE EN MILIEU AGRICOLE
III. PEUT-ON SE PASSER DES CONNAISSANCES NATURALISTES POUR SUIVRE LA BIODIVERSITE ? TEST D’UNE METHODE ALTERNATIVE : LA PARATAXONOMIE
A. LES METHODES D’EVALUATION RAPIDE DE LA BIODIVERSITE
1. La parataxonomie outil de suivi de la biodiversité ?
2. Controverses autour de la parataxonomie
a) Une concurrente de la taxonomie ?
b) Des informations limitées et biaisées?
c) Une méthode non scientifique?
d) Objectifs de notre étude
B. MANUSCRIT : ON THE USE OF PARATAXONOMY IN BIODIVERSITY MONITORING: A CASE STUDY ON WILD FLORA
C. SYNTHESE ET PERSPECTIVES
1. Nécessité de l’honnêteté scientifique dans l’emploi de la parataxonomie…et de toute autre méthode d’inventaire
2. Nécessité de maintenir et renouveler les savoirs naturalistes
IV. EFFET DES PRESSIONS HUMAINES SUR LES COMMUNAUTES DE PLANTES COMMUNES A LARGE ECHELLE : OCCUPATION HUMAINE ET HOMOGENEISATION BIOTIQUE
A. EFFET DES PRESSIONS HUMAINES SUR LES COMMUNAUTES DE PLANTES COMMUNES: ETAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES
1. Origine des données disponibles
2. Les changements documentés
3. L’homogénéisation biotique
a) L’homogénéisation biotique taxonomique
b) L’homogénéisation biotique fonctionnelle
B. MESURER L’HOMOGENEISATION FONCTIONNELLE
1. Notion de spécialisation des espèces
2. Quantification de la spécialisation des espèces
a) Méthodes basées sur l’habitat
b) Méthodes basées sur la co-occurrence entre espèces
C. COMPARAISON DES DIFFERENTS INDICES DE SPECIALISATION CHEZ LES PLANTES
1. Objectifs
a) Origine des données utilisées
b) Calcul des indices
(1) Rareté des espèces
(2) SSI (species specialization index)
(3) IndVal (Indicator value)
(4) Indice de Fridley
c) Étude du lien entre degré de spécialisation et caractéristiques des espèces
3. Résultats et discussion
a) Liens entre les différents indices et la rareté desespèces.
b) Comparaison entre l’indice de Fridley et le SSI
c) Quels indices utiliser sur notre jeu de données?
D. ÉTUDE DE L’HOMOGENEISATION TAXONOMIQUE ET FONCTIONNELLE DES ASSEMBLAGES DE PLANTES COMMUNES
1. Objectifs
2. Manuscrit : Functional and taxonomic response of common plant species assemblages to human disturbance (in. prep.)..103
3. Synthèse, limites et perspectives
V. ETUDE D’UNE PRESSION A L’ECHELLE LOCALE : L’EFFET DES PRATIQUES AGRICOLES SUR LES COMMUNAUTES DE PLANTES COMMUNES
A. CONTEXTE DE L’ETUDE : L’IMPACT CROISSANT DE L’AGRICULTURE SUR LA FLORE SAUVAGE
B. MANUSCRIT : LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES FAVORISENT-ELLES VRAIMENT LA BIODIVERSITE ?
C. SYNTHESE, LIMITES ET PERSPECTIVES
VI. CONCLUSION GENERALE
A. LES INDICATEURS DE BIODIVERSITE : QUELLE PLACE POUR LA FLORE COMMUNE ?
B. LE ZOOCENTRISME EN BIOLOGIE DE LA CONSERVATION
C. VERS UN SUIVI DE LA FLORE DE FRANCE ?
VII. BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet